Le jazz à la lumière
de Jean-Jacques Rousseau
Anne-Marie Mercier-Faivre &Yannick Seité
OUSSEAU NE S
’
EST PAS BORNÉ
à prévoir l’ethnologie : il l’a fondée. »
1
On
pourrait, prolongeant la remarque fameuse de Claude Lévi-Strauss, poser que
Rousseau ne s’est pas contenté d’avoir l’intuition de l’ethnomusicologie mais qu’il
l’a créée. Par exemple, lorsqu’il signale, dans l’article « Musique » de son
Dictionnaire de musique
(1768), à propos de l’air chinois, de l’air persan et des
« deux chansons des sauvages de l’Amérique » qu’il a transcrits à l’intention de son
lecteur pour le mettre « à portée de juger des divers Accens musicaux des Peuples » :
« On trouvera dans tous ces morceaux une conformité de Modulation avec notre
Musique, qui pourra faire admirer aux uns la bonté et l’universalité de nos règles, et
peut-être rendre suspecte à d’autres l’intelligence ou la fidélité de ceux qui nous ont
transmis ces Airs
. »
2
Exactement deux cents ans plus tard, préfaçant son
Early Jazz
(1968), Gunther
Schuller souligne :
« Les explications et les exemples musicaux ne peuvent évidemment pas remplacer la
musique elle-même. Si cela est vrai pour le classique, à plus forte raison pour le jazz,
qui repose sur l’improvisation, défie toute notation, et dans lequel le recours au sol-
fège s’avère sinon impossible, tout au moins inadéquat. »
3
Pas question de prendre ce point de convergence minuscule – repérage d’un fait
musical comme rebelle à la transcription, soupçon jeté sur l’universalité d’un
1. Claude Lévi-Strauss, « Jean-Jacques Rousseau fondateur des sciences de l’homme » (1973), repris dans
Anthropologie structurale deux
, Paris, Pocket, 1996 : 45.
2. Jean-Jacques Rousseau,
Œuvres complètes.
V.
Dictionnaire de musique
, Paris, Gallimard,
(« Bibliothèque de la Pléiade »), 1995 : 924. Les références aux
Œuvres complètes
seront citées
infra OC
,
plus le numéro du volume.
3. Gunther Schuller,
L’Histoire du jazz.
I.
Le premier jazz, des origines à 1930
, Paris, PUF/Marseille,
Parenthèses, 1997 : 9.
Les auteurs remercient Patrick Hochart pour la lecture qu’il a bien voulu faire de ce texte.
L’HOMME
158-159 / 2001,
pp. 35 à 52
“R

36
code ; au-delà, reconnaissance d’une altérité dont la spécificité musicale n’est
qu’un symptôme – comme autre chose que comme un indice, l’indice de paral-
lèles plus vastes dont il va s’agir dans la suite d’explorer les formes et de tirer les
conséquences. De même Rousseau vaudra-t-il ici parfois moins pour lui-même
que comme symbole et porte-parole d’un siècle qui a donné au relativisme cul-
turel sa formulation la plus convaincante et la plus efficace. Nous nous propo-
sons donc de mettre en parallèle les réactions de ceux qui, à l’Âge classique,
furent confrontés aux musiques extra-européennes (africaines en particulier) avec
celles des premiers Européens qui firent la découverte des « jazz nègres ». Il ne
s’agira pas de comparer des musiques mais de contraster des discours, dont on
soulignera en outre qu’ils sont suscités par des temps et des espaces absolument
distincts. D’un côté, la parole de voyageurs qui, aux
XVII
e
et
XVIII
e
siècles, explo-
rèrent, en même temps que le continent africain, ses peuples et leurs pratiques
musicales. De l’autre, la parole des Européens (journalistes, écrivains) qui, entre
les deux guerres, confrontés à la nouveauté du jazz, s’efforcèrent d’en dire les
formes et d’en cerner les effets.
À l’horizon de ce dispositif, sans doute une question aux ambitions si évidem-
ment sidérantes qu’il doit être possible, tant sa réponse apparaît d’emblée inac-
cessible, de la poser sereinement à l’orée de ce travail : pour pasticher la manière
de Jean de Léry, l’un des premiers voyageurs européens à s’être confronté à des
formes musicales non occidentales :
qu’est-ce qu’on peut appeler musique ?
4
–
qu’est-ce que la musique, si l’on préfère ?
La convergence des discours
Une fois rappelé, cet éloignement des objets, des lieux et des temps ne rend
que plus sensible et curieuse ce qu’il faut reconnaître d’emblée comme une
grande proximité des discours. Dans l’incompréhension ou le mépris comme
dans la reconnaissance, voire l’admiration. Commençons donc par l’effroi et la
surdité. Pour nombre des voyageurs de l’Ancien régime, la musique des Africains
est d’abord bruit, cacophonie. C’est ainsi que l’article « Nègre »
5
de l’
Encyclopédie
précise que les danses de ces derniers sont accompagnées de « chants bryants
[sic]
». Mais de semblables mentions sont légion dans l’
Histoire générale des
voyages
6
4. Si l’on suit l’édition que Franck Lestringant a procurée (Paris, Livre de poche, 1994) de l’
Histoire d’un
voyage faict en la terre du Brésil
(1578), deux chapitres du sommaire du récit de Léry recourent à une telle
formulation : le XVI, « Ce qu’on peut appeler religion entre les sauvages Américains » ; et le XVIII, « Ce
qu’on peut appeler loix et police civile entre les sauvages ». Significativement, ils portent sur des institu-
tions éminemment sociales, comme en atteste la reprise de la préposition « entre » : le sens de ces insti-
tutions et leur valeur sociale ne fonctionnent qu’à l’intérieur d’une communauté ; leur inscription dans
le vocabulaire de l’auteur et de ses lecteurs, qui suppose des jugements axiologiques, doit passer par un
examen préalable permettant de décider si ces activités et coutumes peuvent prendre les noms, marqués
positivement ici, de « lois » ou de « religion ». D’où cette prudence – qui néanmoins prend déjà parti.
5.
Encyclopédie
dite « de Diderot et d’Alembert », tome XI : 82. Le
XVIII
e
siècle réserve volontiers le nom
de « Sauvages » aux Américains et parle de « Nègres » pour les Africains.
6. L’abbé Prévost est l’auteur des seize premiers volumes de l’
Histoire générale des voyages, ou nouvelle
collection de toutes les relations de voyage par mer et par terre qui ont été publiées jusqu’à présent dans les .../...
Anne-Marie Mercier-Faivre & Yannick Seité
que l’abbé Prévost compile entre 1746 et 1759. Guinée : « Devant
[le roi] marchoient un grand nombre d’instrumens plus bruyans qu’harmonieux,
tels que des cloches, des trompettes de corne, & d’autres puérilités inconnues des
Portugais » (
HGV
, I : 14). Pays Mandingue, à propos des trompettes de ses habi-
tants : « Ils en ont de différentes grandeurs, qui produisent différents sons.
Cependant ils n’en sortent qu’une sorte de bruit confus, qui a fort peu d’agré-
ment » (
HGV
, III : 174). Et citons encore la mention, à propos du Sénégal, de
« ces bals fréquents [durant lesquels] une calebasse ou un chaudron sert [aux
femmes] d’instrument, car elles aiment beaucoup le bruit » (
ibid.
: 178). D’où
l’effrayant spectacle de ces concerts qui sont autant de sabbats :
37
« Les tambours des Mandingos sont longs d’une aune, sur environ vingt pouces de
diamètre au sommet. […] Le nègre accompagne le son de cet instrument de celui de
sa voix, ou plutôt de ses hurlements. La figure du musicien, relevée par quantité de
grimaces, et le bruit d’une si étrange musique, forment ensemble un horrible amuse-
ment. » (
ibid.
: 174)
Deux siècles plus tard, on trouve chez certains des témoins de l’arrivée du jazz en
Europe des jugements qui consonnent avec ceux-ci. Répondant à l’« Enquête sur
le jazz-band » qu’avaient lancée, dans le journal
Paris-Midi
au printemps de
1925, André Cœuroy et André Schaeffner, l’écrivain Camille Mauclair signalant
que le jazz-band n’était, au gré de ses oreilles, pas « autre chose qu’un vacarme tri-
vial » poursuivait en ces termes :
« … qu’il puisse se créer une musique de jazz-band originale, indépendante, obéissant
à ses lois propres, je ne crois pas, mon cher confrère, qu’elle soit autre chose que le
“barritus” des mercenaires barbares qui mugissaient dans leurs boucliers et en frap-
paient le bord de leurs épées en hurlant, quand ils réclamaient leur solde aux prêteurs
romains de la décadence. Les Huns, en conseil, devaient faire aussi un assez joli
tapage ; on dit grand bien des Sioux et des Pawnies pour le même motif ; on nous
a fait un éloge motivé de la cour de feu Behanzin ; enfin vous savez comme moi, qu’à
la Chambre, avec les pupitres, la cloche et les coupe-papier, il se fait en ce genre
d’excellent travail »
7
.
On n’aura pas de mal à repérer, dans la réponse de Mauclair, un style violemment
polémique qui distingue sa prose de celle, non passionnée, des voyageurs du
XVIII
e
siècle. Sur cette différence de ton, fondamentale, nous reviendrons. Reste
que l’assimilation du premier jazz à du bruit trouve parfois à se dire sur un mode
moins agressif, moins politique si l’on veut. Sollicité par Schaeffner et Cœuroy
de donner son avis sur cette musique nouvelle, Jean Perrier, le « merveilleux inter-
différentes langues
, compilation qui paraît à Paris entre 1746 et 1759. Après un volume de
Tables
(1761),
les tomes XVII à XX parurent entre 1761 et l’an X, rédigés par E. M. Chompré, A. Deleyre, Meusnier
de Querlon et Rousselot de Surgy. Cette référence sera citée
infra HGV
.
7. Ce texte, comme beaucoup de ceux qui servent de base à la présente étude, fait partie du recueil d’ar-
ticles réuni par Olivier Roueff dans le volume d’annexe de son mémoire
Le Jazz des années folles : des com-
battants de l’enfer aux fervents du hot
(Institut d’études politique de Grenoble, année universitaire
1995-1996). Un essai d’Olivier Roueff et Denis-Constant Martin est à paraître dans la collection
« Eupalinos » des éditions Parenthèses. Un large choix de ces textes y figurera, dont l’intégralité de l’en-
quête
Paris-Midi
.
Jean-Jacques Rousseau et le jazz
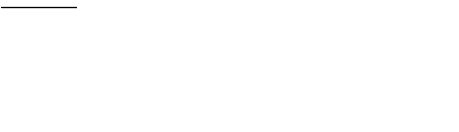
38
prète de Pelléas », bat en retraite horrifié : « Il m’est impossible de vous donner
mon opinion sur une chose que je ne connais pas, et que je fuis éperdument,
détestant le bruit et la cacophonie. » Cacophonie encore chez Jean-Marc Py, mais
cacophonie acceptée, magnifiée à travers une série d’oxymores :
« On voudrait haïr cette cacophonie organisée mais elle vous prend, actionne vos
nerfs, vous force à suivre du pied, des doigts, des épaules et de la tête le mouvement
de sa barbare harmonie. »
8
Une autre des caractéristiques que les voyageurs occidentaux se plaisent (se
déplaisent serait mieux dire) à consigner est la monotonie qui caractériserait bien
souvent la musique africaine. Chez Prévost toujours, on lit, à propos d’Issini :
« Les trompettes sont des dens d’Eléphant, creusées presque d’un bout à l’autre, avec
une petite ouverture au côté, par laquelle le trompette, qui est un enfant de 12 ou 15
ans, souffle et tire un son fort aigu, mais sans aucune variété, tel que celui de nos cor-
nets à bouquins. » (
HGV
, III : 433)
Et le chapitre « Mœurs et coutumes des Jalofs » de l’
Histoire générale des voyages
note :
« Les fluttes et les flageolets des nègres ne sont que des roseaux percés. Ils s’en servent
comme les sauvages de l’Amérique, c’est-à-dire fort mal, et toujours sur les mêmes
tons. Ils n’en tireroient pas d’autres de nos fluttes d’Europe. » (
ibid.
: 175)
La monotonie n’est pas seulement causée par la rusticité d’instruments qui
seraient mal joués mais a partie liée à la tristesse qui émane des airs des Africains :
« La longueur et le diamètre des tambours sont […] différens, pour mettre de la variété
dans les tons. […] Mais en général le son en est mort, et moins propre à réjouir les
oreilles ou à réveiller le courage, qu’à causer de la tristesse et de la langueur.
Cependant, c’est leur instrument favori, et comme l’âme de toutes leurs fêtes. » [En
note : À Bissao, cet instrument s’appelle
Bontalon
.] (
ibid.
: 174)
Et la tristesse, comme les hommes, a traversé l’Atlantique sur les bateaux négriers.
À propos des esclaves, on lit en effet dans l’
Histoire des deux Indes
9
– autre compi-
lation, composée près de vingt ans après celle de Prévost par un abbé Raynal auquel
Diderot, on le sait, a prêté la main :
« Leurs airs sont presque toujours à deux tems. Aucun n’excite la fierté. Ceux qui sont
faits pour la tendresse, inspirent plutôt une sorte de langueur. Ceux même qui sont les
plus gais, portent une certaine empreinte de mélancolie. C’est la manière la plus pro-
fonde de jouir pour les âmes sensibles.
» (
H2I
, Livre XI : chap. 23)
10
8. Jean-Marc Py,
Paris Midi,
12 mai 1925 : 3.
9. Les sept volumes de l’
Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens
dans les deux Indes
paraissent à La Haye en 1770. Une édition augmentée sera publiée en 1774, toujours
sans nom d’auteur. L’édition de 1780, signée par l’abbé Raynal, compte dix volumes. Les rééditions de
ce texte seront constantes dans l’Europe des
XVIII
e
et
XIX
e
siècles. À partir de 1770 selon Michèle Duchet,
plus tôt même, selon Gianluigi Goggi, Diderot collabore activement à l’ouvrage de son ami. On
emploiera
infra
l’abréviation
H2I
, en donnant la référence du livre ou chapitre utilisée par M. Duchet et
en renvoyant en note à l’édition de Londres de 1792 (17 vol.).
10. Édition de 1792, t. 9 : 280-281.
Anne-Marie Mercier-Faivre & Yannick Seité
Si, délaissant la musique instrumentale, on considère un instant les chansons afri-
caines, on les trouvera elles aussi décrites comme lassantes, répétitives (« Trois ou
quatre paroles qui se répètent alternativement entre le chanteur et les assistans en
chœur, forment quelquefois tout le poëme. Cinq ou six mesures font toute l’éten-
due de la chanson »
(ibid.) ,
quand elles ne sont pas dénoncées comme absurdes,
car vides de sens. Towtson, Guinée :
« [Les femmes] entreprirent d’amuser leurs Hôtes par des chansons et des danses qui
ne flattèrent pas beaucoup les Anglois. Leurs chansons consistoient dans les mêmes
mots qu’ils répétoient sans cesse. L’Auteur nous les a conservés. Sakere, sakere, ho, ho,
sakere, sakere ho, ho. » (
HGV
, I : 232)
39
Aussi bien Jaucourt précise-t-il, à propos des Hottentots, dans l’
Encyclopédie
(VIII : 321) que « le nom de
Hottentot
a été donné par les Européens à ces
peuples sauvages, parce que c’est un mot qu’ils se répètent sans cesse les uns aux
autres lorsqu’ils dansent »
11
. La remarque trouve, dans l’
Histoire générale des
voyages
, ses prolongements sur le terrain musical :
« La musique vocale des Hottentots consiste dans le monosyllabe
Ho
, et dans deux ou
trois chansons barbares. Celle qui est particulière aux cérémonies religieuses consiste
dans un petit cercle de notes. Mais en général toute leur musique est fort désagréable
aux oreilles d’un Européen. » (
HGV
, V : 155)
De même la condamnation du jazz pour sa monotonie est repérable chez des musi-
ciens ou des critiques des années 20 et 30. Le compositeur Albert Roussel confie à
Schaeffner et Cœuroy que, « malgré la virtuosité prodigieuse de quelques instru-
mentistes, une audition prolongée de jazz finit par [lui] paraître monotone et aga-
çante »
12
. Quant à Lucien Rebatet, il rend compte, dans
L’Action française
, des
concerts européens qu’Armstrong donna en 1933-1934 dans les termes suivants :
« Il faut l’écouter et le voir : pendant deux heures durant. C’est très vite d’une mono-
tone puérilité. La fameuse improvisation hot consiste à faire tourner indéfiniment
dans une trompette ou un saxophone un tronçon d’air de trois ou quatre notes au
plus. Cet exercice demande simplement du souffle et la connaissance de quelques pro-
cédés rudimentaires d’harmonie. »
13
Comment ne pas rapprocher la « puérilité » perçue par Rebatet de celle dont, à
propos de la Guinée, nous nous faisions, au début de notre texte, l’écho ?
11. Signalons que Prévost, se fondant sur un texte de Kolbe, motive ce nom, dix pages avant l’extrait
cité
supra
, d’une tout autre façon : « Tachard et d’autres écrivains donnent le nom de
Hottentot
comme
un sobriquet, pris de l’usage que les Habitans naturels du Cap font souvent de ce terme, à la rencontre
des Étrangers, ou de celui qu’ils ont, dans leurs danses, de répéter souvent
Hottentottum brokana
.»
(
HGV
, V : 145) Quelques pages encore et Prévost donne une autre explication à cette dernière expres-
sion. Cette formule servirait de refrain dans une danse, et signifierait « donnez ses gages à l’Hottentot »,
rappel de la malhonnêteté d’un Hollandais mauvais payeur. Comme on le voit, le sens existe, il est connu
depuis la première moitié du siècle, mais on préfère l’ignorer pour lui substituer des « glossements sans
raison » (le terme est de Daniel Droixhe, paraphrasant ici Voltaire) qui agissent comme des signaux et
non comme des signes (au sens saussurien) : le sauvage est déclaré intraduisible – et
impayable
. L’absence
d’échange est de l’ordre du réel comme du symbolique.
12. Albert Roussel,
Paris Midi,
8 mai 1925 : 3.
13. Lucien Rebatet,
L’Action française
, 16 janvier 1934, cité par Michel Boujut dans
Pour Armstrong
,
Paris, Éditions Filipacchi, 1976 : 59.
Jean-Jacques Rousseau et le jazz
40
Constatons donc, pour finir cette esquisse d’un parallèle, que non susceptible
d’être enregistrée, difficilement transcriptible, la musique des Africains est saisie
par les voyageurs de l’Âge classique à travers ses effets, à travers la manière dont
elle impressionne l’oreille et la sensibilité. Soit, souvent, en aval,
via
le déplaisir
qu’occasionne son écoute : « leurs tymbales sont de larges bassins, d’un métal
qu’ils appellent
tombago
, et rendent un son fort désagréable » (
HGV
, I : 439)
14
;
« les instrumens du pays sont d’yvoire & de différentes grandeurs, mais ils ren-
dent un son fort désagréable » (
HGV
, II : 509), etc. De telle notations donnent
tout leur prix à des témoignages de plaisir point si rares que cela en définitive :
« Cette musique n’a rien de désagréable » (
ibid.
: 492, à propos de l’expression
musicale du royaume de Kayor). Évoquant les instruments des Foulis, l’
Histoire
générale des voyages
remarque : « ils en ont de plusieurs sortes & leur symphonie
n’est pas sans agrément » (
ibid.
: 512). Tout en conservant l’idée de déplaisir,
Diderot, de son côté, dans ses
Mémoires sur différents sujets de mathématiques
(Paris, Pissot & Durand, 1748), la symétrise – démarche qui constitue une autre
façon de culturaliser le goût et qui laisse donc à la musique des barbares toutes
ses chances d’exister comme musique : « si nous détestons la musique des
Barbares, les Barbares n’ont guère de goût pour la nôtre »
15
.
Mais c’est le père Labat qui, partant du constat d’un désagrément, en arrive
pourtant à formuler un relativisme qui constitue une étape remarquable dans la
longue entreprise de l’assimilation de l’inouï. Labat, qui « n’a jamais mis les pieds
en Afrique »
16
est pourtant l’auteur d’une
Nouvelle relation de l’Afrique occiden-
tale
(Paris, Cavelier, 1728)
.
Il s’agit encore, on s’en doute, d’une compilation de
récits de voyage antérieurs. Il a en revanche séjourné aux Antilles comme supé-
rieur de mission et en a ramené un fort intéressant
Nouveau Voyage aux Isles de
l’Amérique
(Paris, Cavelier, 1722)
17
, que Schaeffner prit en compte lors de la
rédaction de son étude
Le Jazz
. Les Noirs dont il est question dans ce texte ne
sont donc plus ceux, libres, que décrivent les explorateurs de l’Afrique mais les
esclaves des colonies françaises des Antilles. Labat écrit :
« Leur musique est peu agréable et leurs accords peu suivis. Il y a cependant des gens
qui estiment cette harmonie autant que celles des paysans espagnols et italiens, qui ont
tous des guitares et en jouent très mal. Je ne sais s’ils ont raison. »
La remarque n’importe pas seulement par la suspension du jugement esthétique
qui s’y donne –
in extremis
– à lire
18
et constitue un préalable indispensable à l’ac-
1971) : 35.
17. Et dont Michel Le Bris a récemment procuré une édition – au texte malheureusement abrégé et à la
langue modernisée – à laquelle nous renverrons : Jean-Baptiste Labat,
Voyages aux Isles. Chronique aven-
tureuse des Caraïbes 1693-1705
, Paris, Phébus, 1993 ; la citation est à la p. 231.
18. On trouverait d’autres exemples de cette attitude, notamment chez Lafitau qui, dans ses
Mœurs des
sauvages américains comparées aux mœurs des premiers temps
(Paris, Saugrain aîné, 1724), note qu’il a
.../...
éd.
Anne-Marie Mercier-Faivre & Yannick Seité
14. Mais l’
Histoire générale des voyages
, fait ici référence aux percussions des « Javans » (les habitants de
l’île de Java) et nous voilà donc à notre tour en grand danger d’essentialiser subrepticement un sauvage…
15. Cité par Béatrice Durand-Sendrail,
La Musique de Diderot. Essai sur le hiéroglyphe musical
, Paris,
Kimé, 1994 : 134.
16. Michèle Duchet,
Anthropologie et histoire au siècle des Lumières
, Paris, Albin Michel, 1995 (1
re
cès à la reconnaissance d’un bruit comme une musique ; elle se signale par la
manière dont elle substitue une logique sociale à une logique que nous dirons
« raciale ». L’altérité musicale renvoie ici à une altérité qui n’est plus anthropolo-
gique au sens où elle serait fondée sur la couleur de la peau – rappelons qu’« au
milieu du
XVIII
e
siècle, le mot
anthropologie
[…] signifie “l’étude du corps
humain” »
19
– mais sur un
criterium
social de commune appartenance à la pay-
sannerie. Au statut servile des uns correspond en outre l’appartenance des autres
à des nations étrangères. Étrangères mais pourtant voisines, catholiques, médi-
terranéennes, comme celle dont est issu le père Labat. La notion d’altérité ici,
donc, se complique. Aussi bien le rapprochement entre musique des Noirs et
musique du peuple deviendra-t-il un classique du discours des Lumières. En
1785, le musicologue Michel Chabanon – récemment établi par Claude Lévi-
Strauss en précurseur de Saussure
20
– souligne en effet :
« L’incohérence du chant & des paroles se fait sentir dans les chansons des Nègres qui
peuplent nos Colonies. Ils mettent en chant tous les événemens dont ils sont
témoins ; mais que l’événement soit heureux ou sinistre, l’air n’en a pas moins le
même caractère.
Les Matelots, & en général tous les hommes du peuple & de la campagne, mettent
dans leur chant je ne sais quelle inflexion traînée, qui lui donne un caractère de tris-
tesse. Ce caractère n’est senti que par des oreilles musiciennes ; le peuple l’ignore, c’est
avec gaîté qu’il chante tristement. »
2
1
En un siècle où Chamfort pouvait écrire : « Les pauvres sont les nègres de
l’Europe », le rapprochement du Nègre et du Matelot autour d’un commun
aveuglement sur le caractère de leur musique n’étonnera qu’à demi. Dans l’un
comme dans l’autre cas, seule une oreille magistrale peut percevoir la façon dont
l’aliénation sociale du sujet se traduit par l’impossibilité qui lui est faite d’accé-
der aux significations véritables de sa propre musique.
On voit que les préoccupations des plus libres des voyageurs et des philosophes
des Lumières convergent vers les inquiétudes des plus inspirés des observateurs
européens du jazz naissant vers une unique et fondamentale interrogation
qu’André Schaeffner et André Cœuroy placeront, en 1925, au cœur du ques-
tionnaire qu’ils adressent à plusieurs figures du monde musical français : cette
musique, est-ce de l’art ? Il faut alors reprendre et compléter un passage de
l’
Histoire des deux Indes
que nous avons commencé à citer plus haut :
« Trois ou quatre paroles qui se répètent alternativement entre le chanteur et les assistans
en chœur, forment quelquefois tout le poëme. Cinq ou six mesures font toute l’étendue
de la chanson. Ce qui paroit singulier, c’est que le même air, quoiqu’il ne soit qu’une
répétition continuelle des mêmes tons, les occupe, les fait travailler ou danser pendant
41
fini par s’habituer aux chants et aux danses du Canada, tout en avouant qu’il a du mal à croire que Jean
de Léry ait éprouvé au Brésil un plaisir esthétique tel qu’il le décrit.
19. Michèle Duchet,
op. cit.,
1995 : 12.
20. Voir Claude Lévi-Strauss,
Regarder Écouter Lire,
Paris, Plon, 1990, en particulier la deuxième section
intitulée « Les paroles et la musique ».
21. Michel Chabanon,
De la musique considérée en elle-même et dans ses rapports avec la parole, les langues,
la poésie et le théâtre
, Genève, Slatkine reprints (1
re
éd. Paris, Pissot, 1785), 1969 : 45-46.
Jean-Jacques Rousseau et le jazz

42
des heures entières : il n’entraîne pas pour eux, ni même pour les blancs, l’ennui de l’uni-
formité que devroient causer ces répétitions. Cette espèce d’intérêt est dû à la chaleur et
à l’expressivité qu’ils mettent dans leurs chants. » (
H2I,
XI : chap. 23)
22
Est-il besoin de souligner la portée (disons-là anthropologique, pour aller au plus
court) de cette simple précision : « ni même pour les blancs » ? Ce qui explique
l’absence de tout « ennui » à l’écoute d’une musique pourtant basée sur la répé-
tition, ce qui fonde « cette espèce d’intérêt », c’est ce que Rousseau – le mot appa-
raissait dans la première citation que nous faisions de cet auteur, à l’ouverture de
notre texte – appelle « l’accent ». Cette « chaleur », cette « expressivité » par quoi
un matériau considéré comme non musical voire comme anti-musical accède
soudain à une existence musicale
23
, c’est
l’accent
24
même de Rousseau.
Finissons alors en citant, toujours puisée dans le même ouvrage, telle remarque
qui, bien qu’appliquée aux Canadiens, rend pourtant un hommage général à l’am-
bition pédagogique des Lumières. On ne s’étonnera pas qu’elle soit due à Diderot :
« Leur chant, dit-on, est monotone. Mais ceux qui l’ont jugé tel avoient-ils une oreille
propre et faite à les bien entendre ? La première fois qu’on parle devant nous une
langue étrangère, tout nous y paroît continu, dit et prononcé du même ton, sans
aucune inflexion, sans prosodie. On ne commence à distinguer les mots, les syllabes,
à s’appercevoir que les unes sont plus sourdes, les autres plus aigues, ont plus ou moins
de durée, qu’après une assez longue expérience. Ne faudroit-il pas, du moins, autant
de tems pour prononcer sur la mélodie d’un peuple qui doit toujours être subordon-
née à sa langue ? » (
H2I
, XV : chap. 4)
25
Ce sont peut-être de telles interrogations qui, lointainement, ont préparé les pre-
miers auditeurs européens du jazz, dont le témoignage nous a été conservé, à l’ac-
cueillir avec enthousiasme ou sympathie. Car telle est bien l’impression
dominante. Du même coup, la présence de voix discordantes exige d’être inter-
prétée. Il y a là d’une certaine manière, dans la prose des Suarès, Rebatet,
Mauclair et chez d’autres encore
26
, une régression par rapport aux réactions des
voyageurs confrontés à l’inouï d’une musique noire. Mais cette régression est le
revers d’un progrès : celui, bien sûr, du racisme. Il importe alors de dire que
Mauclair comme Rebatet seront parmi les idéologues fascistes les plus influents
de la France de Vichy. La réponse de Mauclair à l’enquête de Cœuroy et
22. Édition de 1792, t. 9 : 280.
23. Redessinant du même coup les frontières séparant ce qui est musique de ce qui ne l’est pas.
24. Sur cette notion, fondamentale à la pensée de Rousseau (elle est au cœur de l’
Essai sur l’origine des
langues,
le philosophe lui consacre un long article de son
Dictionnaire de musique
) et d’une très difficile
saisie, nous renverrons aux travaux d’André Wyss – en particulier à son livre
Jean-Jacques Rousseau, l’ac-
cent de l’écriture
, Neuchâtel, La Baconnière, 1988 – qui, dans l’article « Langue et style » de Raymond
Trousson & Frédéric S. Eigeldinger, eds,
Dictionnaire de Jean-Jacques Rousseau
, Paris, Champion, 1996,
remarque (p. 488) : « Ce qui est à l’origine du langage est à la fois antérieur à la langue et définitivement
absent de lui, comme un manque irrémédiable. Le premier langage n’est qu’un
accent
, c’est-à-dire la pré-
sence totale d’un être comme unique référé à l’intérieur même du message. »
25. Édition de 1792, t. 13 : 43-44.
26. Ainsi de Monsieur René Brancour, conservateur au Musée du Conservatoire de musique de Paris
qui, sollicité par Schaeffner et Cœuroy, leur écrit : « Si la danse de Saint-Guy et les ébats des chimpanzés
relèvent de l’art chorégraphique, le jazz-band relève de l’art musical – ni plus ni moins. » (
Paris-Midi,
23
juin 1925 : 3.)
Anne-Marie Mercier-Faivre &Yannick Seité

Schaeffner en particulier est instructive. Elle commence par une assimilation du
jazz au « barritus » des mercenaires barbares qui est l’embrayeur implicite mais
efficace d’une autre assimilation : celle des Noirs américains qui, en 1917, débar-
quèrent à Brest ou à Saint-Nazaire avec le jazz dans leurs besaces à de nouveaux
barbares mis au service des civilisés. Elle se poursuit par une manifestation d’an-
tiparlementarisme bien dans la note de la Troisième République, dont on sait à
quel riche avenir il était promis. Chez ces extrémistes méthodiquement sourds
27
,
la saisie idéologique s’est entièrement substituée à l’approche anthropologique
ou, si l’on veut, l’anthropologie physique a pris la place de l’ethnologie. Le rap-
pel sur lequel Mauclair conclut sa réponse n’a dès lors rien pour étonner : « … et
puis, j’appartiens à la race blanche ».
Mis à part ces cas d’espèce, malheureusement assez nombreux, le problème
que soulève en définitive cette convergence relative des discours que nous nous
sommes attachés à mettre en évidence nous semble être le suivant : pourquoi, à
deux siècles d’intervalle, ces similitudes de réaction devant des modes d’expres-
sion musicaux bien sûr esthétiquement et historiquement liés, mais aussi en défi-
nitive très sensiblement différents ?
43
La différence des musiques
« Dans le jazz », rappelle Lucien Malson, « la rencontre de deux traditions,
noire et blanche, s’effectue, mais sur celle-ci celle-là l’emporte »
28
. Ce qui revient
à dire la parenté fondamentale mais aussi l’irréductibilité de l’un à l’autre des
deux arts musicaux, africain d’une part, afro-américain de l’autre. Si bien que ce
qui finit par assurer la continuité entre les deux univers musicaux est bien sûr de
l’ordre du musical – l’attention prêtée au rythme, le souci de « vocalisation » du
son instrumental, la confusion précieusement entretenue entre le son et le bruit,
etc. – mais est aussi de l’ordre plus global d’une culture voire d’une couleur, cette
couleur de la peau qui est, qui serait, commune aux musiciens de l’une et de
l’autre rive de l’océan Atlantique. Le héros de l’ouvrage pionnier de Schaeffner a
un nom, n’a qu’un nom il est « le nègre »
29
. Cette unicité du nom est l’indice
d’une approche délibérément unificatrice d’une réalité musicale en elle-même
bien sûr multiforme :
André Cœuroy, 1926).
29. En 1927, un an après la publication de
Le Jazz
, Philippe Soupault intitulera précisément
Le Nègre
un roman qui promène son lecteur d’Afrique en Amérique, d’Haïti à Barcelone ou Paris… Et, en 1934
encore, c’est sous le simple titre
Negro
que Nancy Cunard fait paraître une anthologie fameuse. Elle pré-
cise dans son avant-propos : « It was necessary to make this book – and I think in this manner, an antho-
logy of some 150 voices of both races – for the recording of the struggles and achievements, the
persecutions and the revolts against them, of the Negro peoples. » Il est vrai que la mode est alors à
débattre de ce qu’on appelle le « problème noir ».
Jean-Jacques Rousseau et le jazz
éd. avec
27. En cela qu’ils n’entendent que la note et se rendent sourds à l’accent.
28. Lucien Malson, « Premier livre sur le jazz et ses racines africaines », repr. en postface à André
Schaeffner,
Le Jazz
, Paris, Jean-Michel Place (« Les Cahiers de Gradhiva » 2), 1988 : 160 (1
re
44
Des musiques violentes d’Afrique aux chants des planteurs des Antilles ou de la
Louisiane, aux
spirituals
, au
jazz
enfin, il ne s’agit jamais que d’un même fait musical,
sous des aspects étrangement peu variés…
30
On voit que ce qu’André Schaeffner prend en considération dans son étude
31
c’est ce qu’il appelle la « musique nègre »
32
. On peut, dans un geste réflexe,
d’abord être tenté de lui faire grief d’avoir ainsi rassemblé des réalités diverses
sous un étendard abusivement fédérateur. Un tel geste intellectuel ne constitue-
rait-il pas une régression par rapport à telle analyse de Chabanon qui, alors qu’il
se demande si « le caractère de chant le plus familier à une Nation, n’est pas un
indice certain de son caractère & de son génie »
33
, remarque :
« Les personnes qui ont fait une distinction marquée entre le chant du Nègre Arada et
celui de la côte d’Angol, affirment que le premier, dont la mélodie lente, traînée, invite
à la tristesse, est sensible, passionné, jaloux dans ses amours, sujet au crime dans ses
jalousies et dans ses haines ; la trempe mélancolique de son âme le porte à se tuer dès
que le fardeau de la vie le fatigue. Le Nègre de la côte d’Angol, léger, étourdi, vif, pétu-
lant, ignore ces passions sombres et funestes ; ses chants sont l’indice de sa gaieté, de
son heureuse constitution. Si l’esclavage lui pèse, il s’y dérobe par la fuite, non par la
mort. On le voit fugitif, errant, vagabond, ses malheurs mêmes ne semblent point alté-
rer sa gaieté naturelle. »
34
Sans doute la page de Chabanon est-elle une étape importante, pour ce qui est
de la musique, dans l’apprentissage d’une différence qui n’est pas la différence
entre Moi et l’Autre, le Blanc et le Noir par exemple, mais cette autre différence,
d’une saisie plus difficile encore, d’une plus exigeante tenue, qu’est la différence
entre l’Autre et l’Autre. Pourtant, faire jouer ce texte contre Schaeffner serait
injuste, naïf, absurde.
D’abord parce que celui-ci a pleinement conscience que ce qu’il appelle « l’es-
prit nègre »
35
connaît des incarnations multiples. Incarnations instrumentales,
par exemple : aussi bien se désole-t-il de « ne saisir d’une prodigieuse multiplicité
d’instruments que quelques exemplaires »
36
. À l’inverse, il faut rappeler que le
répertoire des Hellfighters, l’orchestre (à l’origine militaire) par lequel James
Reese Europe contribua à répandre le jazz en France tout au long de l’année 1918
était, entre marches,
Marseillaise
et blues, profondément éclectique. Rappeler
aussi que lorsque Will Marion Cook, venu de Washington, triomphe à Londres,
en 1919, à la tête du Southern Syncopated Orchestra, c’est avec un programme
30. André Schaeffner,
op
.
cit
., 1988 : 14.
31. Dont on rappellera au passage (voir Lucien Malson, « Premier livre sur le jazz et ses racines afri-
caines », 1988, art. cit. : 156) que les
Cahiers du Jazz
, en 1965, republieront en chapitres sous le titre,
significativement différent et approuvé par l’auteur,
Les Racines africaines du jazz
.
32. André Schaeffner,
op
.
cit
., 1988 : 20.
33. Michel Chabanon,
op
.
cit
., 1969 : 101. Signalons que Chabanon apporte à sa propre interrogation
une réponse négative.
34.
Ibid
. : 94-95.
35. Dans son fameux article de 1919, paru dans
La Revue romande
, Ernest Ansermet écrit : « La musique
nègre n’est pas matière, elle est esprit. » Cf. Ernest Ansermet, « Sur un orchestre nègre »,
La Revue
romande
, 1
er
octobre 1919, repris dans
Jazz Magazine,
janvier 1984, 324 : 33.
36. André Schaeffner,
op
.
cit
., 1988 : 16.
Anne-Marie Mercier-Faivre & Yannick Seité
qui, nous dit Christian Béthune, comprend « peu de jazz au sens étroit du
terme ». Et le biographe de Sidney Bechet de poursuivre :
« L’intention de Marion Cook était en fait de présenter à l’Europe un vaste panorama
de la musique américaine (Haïti et Cuba y figurent en bonne place) soulignant à la
fois la dette du Nouveau Continent à l’égard de la musique noire et la qualité de l’as-
similation par les musiciens afro-américains de l’héritage savant occidental. »
37
45
L’éclectisme de ces répertoires, en un temps ou le mot même de « jazz » com-
mence à peine à avoir cours, loin de faciliter la tâche du musicologue n’a d’abord
pu que précipiter les confusions. Il faut donc comprendre la construction par
Schaeffner de l’objet « musique nègre » par rapport à un moment. Comme un
moment. Moment pédagogique, moment heuristique qui constitue, après le pré-
cédent des Lumières, l’autre grand moment de critique de l’Occident par lui-
même. Dialoguant avec Jean Jamin, Michel Leiris se souvient :
« On était nettement contre l’Occident. D’ailleurs, dans les déclarations surréalistes et
dans les manifestes, cela est marqué d’une façon violente : il s’agit bel et bien d’une
rébellion contre la civilisation occidentale. »
38
D’une certaine manière, Schaeffner, qui jamais ne fut surréaliste, Schaeffner, l’ad-
mirable connaisseur de Debussy et de la totalité de la tradition musicale euro-
péenne
39
pourtant implicitement opère, depuis l’Occident mais
via
le jazz, une
critique – critique esthétique – de l’Occident. Quiconque ainsi procède peut,
doit en toute légitimité, en toute nécessité poser d’abord, postuler d’abord l’unité
voire l’unicité d’une « musique nègre »
40
. Cette « recherche d’une essence du jazz
et de la musique afro-américaine »
41
était un moment nécessaire, un passage
obligé, en ce milieu des années 20 ; un instrument heuristique particulièrement
efficace dans les mains de certains auditeurs et musiciens inspirés. Pour le reste,
pour se mettre en posture de saisir le divers sous l’un, la variété dans l’essence, il
faut du temps (Diderot, dans un des passages de l’
Histoire des deux Indes
que nous
citions plus haut le soulignait déjà) ; il y faut une éducation. Il faut aussi en
quelque sorte que la découverte de l’Autre et les implications critiques qu’elle
induit aient pleinement fait sentir leurs effets.
En 1929 encore, le critique et musicologue Émile Vuillermoz peut rendre
compte dans
Candide
d’un livre du docteur Stephen Chauvet consacré à « la
musique nègre»
42
. Il n’en est que plus significatif de lire, sous la plume du même
critique, en janvier 1930, un texte dont nous livrons l’extrait suivant :
37. Christian Béthune,
Sidney Bechet
, Marseille, Parenthèses, 1997 : 48.
38. Michel Leiris,
C’est-à-dire
, Paris, Jean-Michel Place, 1992 : 11.
39. Deux volumes parus chez Fayard en 1998 viennent rappeller la culture et la variété des intérêts de
Schaeffner :
Variations sur la musique
et
Correspondance Pierre Boulez-André Schaeffner
.
40. Songeons aussi, dans un autre contexte, à la mise en circulation par l’Association for the
Advancement of Creative Musicians, à partir du milieu des années 60, de la notion de Great Black Music
– concept aux résonances tant politiques qu’esthétiques et que l’Art Ensemble of Chicago mit en œuvre
de la plus flamboyante manière.
41. Lucien Malson, 1988, art. cit. : 156.
42. Voir
Candide
, 25 juillet 1929 : 11. Vuillermoz y livre sa lecture de Stephen Chauvet,
Musique nègre.
Considérations, technique, instruments de musique (92 fig.), recueil de 118 airs notés
, Paris, Société .../...
Jean-Jacques Rousseau et le jazz
46
« Le snobisme “mélanique” est en période de régression. C’est fort heureux, car à la
place d’un engouement de commande, nous voyons naître une connaissance plus
approfondie des ressources de l’art de “couleur”. Depuis que tout le monde ne roule
plus des yeux blancs en parlant de la musique nègre, on commence à distinguer dans
la pigmentation artistique des nuances un peu plus subtiles.
Ces jours derniers, on nous a présenté un orchestre cubain qui nous apporte, dans
ce domaine, des indications fort instructives. Le nègre, on le sait, possède des dons
musicaux exceptionnels. La sensibilité de son corps à l’influx du rythme est légendaire.
Aucun blanc n’est capable de tenir un mouvement avec cette liberté, cette souplesse,
cette fantaisie et partant cette régularité inflexible et cette précision. Mais le nègre
s’imprègne avec une rapidité extrême de tous les impondérables musicaux des pays où
il s’installe. En quelques années, le vieil idéal africain de trémoussements spasmo-
diques accompagnés de pulsations savantes, s’adapte avec une merveilleuse plasticité
aux traditions locales. Placé sur tous les points du globe, le nègre devient une sorte
d’alambic musical qui absorbe les produits du terroir les plus différents, les distille et
en tire un suc dont le parfum varie à l’infini.
Les nègres de Cuba ont obtenu ainsi la quintessence des rythmes espagnols et
même de la vieille contredanse normande qui rôdait dans les ports, grâce aux escales
des matelots ibériques et des boucaniers français. Habaneras, tangos, boléros, zapatea-
dos, tout en conservant leur profil mélodique et leur coupe caractéristique, ont subi la
transformation réellement féerique créée par les merveilleuses ressources de percussion
dont le nègre ne peut se passer. »
43
L’idée d’une musique nègre et l’essentialisation de son créateur (« le nègre ») sont
ici à la fois présentes, une fois de plus affirmées et pourtant dépassées. Ce texte
saturé de lieux communs ménage malgré tout la faculté de se faire entendre à
quelque chose qui ne saurait plus être « la musique nègre » mais qui ressemble en
revanche aux musiques noires… Bientôt on verra « sourdre des Caraïbes une
forme de musique proche et distincte de ce jazz »
44
. Dire, avec Lucien Malson,
qu’« on voit sourdre » cette musique c’est signifier en fait que désormais il nous
est possible de l’entendre. Qu’elle est repérée, audible, reconnaissable. Audible
pour elle-même, dans sa spécificité.
La simplicité comme puissance critique
Finissons sur cette question de l’unité en faisant retour à Jean-Jacques Rousseau.
À la toute fin de sa vie, dans ces moments où, de retour à Paris, il ne cesse de
répondre à la foule de ceux qui l’accablent de visites « Je ne pense plus, Je ne veux
plus penser, Je n’écris plus, Je n’écris pas, Je suis un écrivain au passé », etc., il arrive
pourtant à Rousseau, délaissant les herbiers et la copie de musique, de se livrer à la
d’éditions géographiques, maritimes et coloniales, 1929. La « musique nègre » dont il est question dans
cet ouvrage est strictement africaine. Notons que Schaeffner, en préface à son
Origine des instruments de
musique
(1936), fait, non sans une certaine désinvolture, un sort au livre de Chauvet.
43. Émile Vuillermoz, « Harmonie blanche et noire »,
Candide
, 16 janvier 1930 : 12.
44. Lucien Malson, « La coutume caraïbe », reéd. dans
Des musiques de jazz
, Roquevaire, Parenthèses,
1983 : 164.
Anne-Marie Mercier-Faivre &Yannick Seité

création
45
. Pas littéraire, la création, il est vrai : musicale. Rousseau compose, mais
à peine. Discrètes compositions. Modestes, mesurées. À distance des grandes
formes et des genres nobles, il compose des romances, des chansons. Le recueil en
paraîtra après sa mort, en 1781, par les soins du Marquis de Girardin sous le titre
Les Consolations des misères de ma vie, ou Recueil d’airs, romances et duos
(Paris, de
Roulle de la Chevardie & Esprit, 1781). À l’époque, Rousseau s’effarouche si fort
à l’idée d’être confronté au verbe que c’est aux autres, aux amis, aux disciples si l’on
veut, qu’il réclame des textes. Chacun y va de son duo, de son ariette. Rousseau met
aussi en musique Shakespeare, Métastase, Baïf, Marot, etc. Or, on trouve dans la
liste de ses productions une
Chanson nègre
. Ce titre est accompagné de la précision
suivante : « Paroles fournies par M. de Flamanville »
46
. En voici le texte, d’après le
recueil gravé en 1781
47
:
47
Chanson nègre
1
Lisetto quitté la plaine
Moi perdi bonheur à moi.
Yeux à moi semblent fontaine
Dipis moi pas miré toi.
Le jour quand moi couper canne
Moi penser à l’amour moi
La nuit quand moi dans cabanne
Dans dormir moi quimbe toi.
2
Quand toi zaller à la ville,
Toi trouver jeune cangnion
Qui gagné pour tromper fille,
Parler doux comme sirop,
Toi sembler bouche sincère ;
Tandis cœur yo coquin trop ;
C’est serpent qui contrefaire
Crier rat pour tromper yo.
3
Maigrir moi tant comme souche,
Jambe à moi comme roseau ;
Sirop n’a pas doux dans bouche,
45. Sur le Rousseau de ces années-là, sur les postures qui sont les siennes au soir de sa vie, nous nous
permettons de renvoyer à Yannick Séité, « La visite au non-écrivain, ou quand Rousseau ruse avec le
verbe »,
Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau
, 1999, XLII : 209-236.
46. Sur le chevalier de Flamanville, voir Louis Aurenche, « Un dernier ami de Jean-Jacques Rousseau. Le
chevalier de Flamanville »,
Revue catholique de Normandie
, 1921 : 13-37. L’étude d’Aurenche ne dit mal-
heureusement rien des circonstances dans lesquelles le chevalier de Flamanville, gentilhomme normand
qui jamais ne voyagea aux îles, eut connaissance puis transmit à Rousseau les paroles de ce qui allait deve-
nir la
Chanson nègre
.
47. La chanson, qui porte le n° 54, se trouve p. 98. Sur le
Recueil
, on pourra consulter l’article que lui
consacre Daniel Paquette in R. Trousson & F. S. Eigeldinger, eds,
op. cit.,
1996 : 171-172.
Jean-Jacques Rousseau et le jazz

48
Taffiat même est comme d’iau ;
Plus danser dimanche et fête,
Plus chanter siffler oiseau,
Manier moi venir tout bête,
Tant chagrin manié moi.
4
Lisette, à moi toi nouvelle
Toi qu’aller bientôt venir,
Venir donc toujours fidelle
Va bon passé tems ici ;
N’a pas tarder d’avantage,
Toi moi faire assez chagrin
Si cœur à toi pas volage,
Toi dois souvenir Colin.
Travaillant sur les proclamations en créole de Sonthonax et Bonaparte, Jean
Bernabé souligne que « l’existence de documents de cette sorte est assez rare au
XVII
e
, au
XVIII
e
et pendant une bonne partie du
XIX
e
siècle ». Ne font exception,
précise-t-il, que « des textes tels que
Lisette quitté la plaine
, chanson en vogue au
XVIII
e
siècle à Saint-Domingue »
48
. La voilà donc, la
Chanson nègre
de Rousseau.
Ou plutôt, voilà retrouvée la source de ses paroles : c’est un authentique texte
créole que Rousseau a mis en musique.
À peine cette dernière phrase écrite que l’on conçoit qu’il va falloir s’entendre
sur chacun de ses mots ou presque. Sur le sens ici des adjectifs « authentique » et
« créole », par exemple. Louis Morpeau, dans son
Anthologie d’un siècle de poésie
haïtienne
, signale en effet que :
« … quelques spécimens plutôt rares du créole littéraire du
XVIII
e
siècle sont parvenus
jusqu’à nous, grâce à des blancs “créoles” lettrés qui mirent en des vers à la grâce
vieillotte et charmante, harmonieuse et désuète, les plaintes de quelque esclave noir
amoureux ou les sanglots de quelque mulâtresse abandonnée. Duvivier de la
Mahautière, sans doute, stylisa la célèbre
Lisette quitté la plaine.
»
49
Puis il cite quelques strophes de la chanson – dans une version qui diffère
d’ailleurs sensiblement de celle mise en musique par Rousseau. Les études les
plus récentes
50
confirment apparemment dans son rôle Duvivier de la
Mahautière. Mais de quel rôle exactement s’agit-il : collecteur, adaptateur – « sty-
lisa », écrit Morpeau –, pur et simple auteur… ? Nous ne le saurons sans doute
48. Jean Bernabé, « Les proclamations en créole de Sonthonax et Bonaparte : graphie, histoire et glot-
topolitique », in Michel L. Martin & Alain Yacou, eds,
De la Révolution française aux révolutions créoles
et nègres
, Paris, Éditions caribéennes, 1989 : 136.
49. Louis Morpeau,
Anthologie d’un siècle de poésie haïtienne 1817-1925, Avec une étude sur la Muse
haïtienne d’expression française et une étude sur la Muse haïtienne d’expression créole
, Paris, Bossard, 1925 : 19.
50. Voir, par exemple, la contribution d’Ulrich Fleischmann à A. James Arnold, ed.,
A History of
Literature in the Caribbean
, Amsterdam-Philadelphia, John Benjamins Pub. Co., 1994, en particulier,
vol. I : 327-328. Fleischmann évoque « the poems
Lisette quitté la plaine
, 1757, written by a white
Creole, Duvivier de la Mahautière ;
Adieu foulards, adieu madras
, 1769, by the French governor of
Guadeloupe, Bouillé ».
Anne-Marie Mercier-Faivre & Yannick Seité
jamais et l’on voit que si la chanson de Rousseau est « nègre », c’est un peu à la
manière dont peuvent l’être les
Demoiselles d’Avignon
de Picasso …
51
Bref, l’attribution de ce texte à un « white Creole » (Ulrich Fleischmann)
explique largement le sentiment qu’éprouve son lecteur de se trouver devant un pur
exemple de pastorale, à ceci près que le berger est coupeur de canne et que l’eau des
sources est devenue taffiat. Le prénom de Colin, qui apparaît au dernier vers du
texte tel qu’il a été mis en musique par l’auteur du
Contrat social
, arrime d’ailleurs
l’élégie dans la tradition pastorale. Le héros de l’intermède de Rousseau,
Le Devin
de village,
n’a-t-il pas nom Colin ? Tout se passe donc comme si Rousseau avait reçu
des mains de son ami le chevalier de Flamanville un texte qui, loin de figurer l’Autre
et l’Ailleurs, n’était que du Rousseau créole, du Rousseau traduit en créole. S’il ne
l’a pas écrit, ce texte lui était pourtant en somme destiné.
Or, quelle musique dépose-t-il au pied de l’élégie ? Un air en 3/4 qui, avec son
unique dièse à la clef, est d’une simplicité absolue, recherchée. Qui verrait, dans
cette manière, l’indice d’une volonté de Rousseau de se mettre au diapason des
sentiments rustiques et du langage « nègre » se tromperait. Rousseau, en rédui-
sant à l’essentiel sa chanson, n’adresse nulle révérence à quelque bon sauvage que
ce soit. Il ne
compose pas petit nègre
comme on dit que l’on « parle petit nègre ».
Non. L’esthétique dépouillée, minimale qui rend sa chanson remarquable règne
sur l’ensemble d’un recueil dans lequel se signale, par exemple, un
Air sur trois
notes
. Finalement non exotique par son texte, la chanson ne l’est pas plus par sa
mélodie. Rien de plus rousseauiste que cette
Chanson nègre
. Rien de plus musi-
calement « nègre » pourtant que cette chanson qui n’a absolument aucun rapport
rythmique
52
, mélodique, harmonique avec quelque musique noire que ce soit.
Justifions-nous rapidement de ce paradoxe.
Sur la capacité de l’être humain, individu ou espèce, à revenir à une simplicité
qui peut-être fut celle des premiers temps, Rousseau, contrairement à ce que de
mauvais lecteurs ont pu croire ou faire semblant de croire, ne s’est jamais illu-
sionné. Pour ne citer qu’un seul de ses énoncés à ce propos, mais remarquable-
ment dense il est vrai : « on ne revient pas plus à la simplicité qu’à l’enfance »
53
.
En revanche, plus profondément que quiconque, il a pensé, intimement vécu jus-
qu’à la déchirure et la folie, l’impossibilité d’une telle régression qu’il juge par
ailleurs non souhaitable. Il n’empêche qu’au soir de sa vie, dans ses écrits (car il
écrit bien sûr ; quoi qu’il en dise, il écrit) comme dans sa musique, il lui arrive de
rêver ce retour. D’ébaucher un geste créateur qui irait dans ce sens. Les romances,
dans leur simplicité radicale, dans le dénuement de leur ligne mélodique sont une
critique de la musique de son temps. Critique de la musique qu’il a pu lui arriver
49
51. Sur ce que ce tableau fameux doit (ou ne doit pas) aux « Nègres » ou à ce qui fut appelé « art nègre »,
lire les analyses d’Anne Baldassari dans le catalogue de l’exposition,
Le Miroir noir. Picasso, sources photo-
graphiques, 1900-1928
, Paris, Réunion des Musées nationaux, 1997 : 69-115.
52. Pour ce qui concerne le jazz, il faut attendre la
Jitterbug Waltz
de Fats Waller (1942) pour qu’une
composition à trois temps fasse véritablement son entrée dans le répertoire.
53. Formule empruntée à la lettre n° 3256, tome XX de la
Correspondance complète de Rousseau
, Oxford,
Voltaire Foundation, 1965-1998. Rousseau l’adresse en mai 1764 à Henriette ***, une lectrice demeu-
rée anonyme.
Jean-Jacques Rousseau et le jazz
50
à lui-même d’écrire, bien sûr ; critique surtout de l’harmonie et des richesses d’un
Rameau, critique de ce qu’il appelle, dans
Les Rêveries du promeneur solitaire
, «le
tortillage moderne »
54
. Ainsi, dans une note jointe à son recueil, il avertit : « Dans
toute ma musique je prie instamment qu’on ne mette aucun remplissage partout
où je n’en ai pas mis », et un témoin du temps, Rochlitz, rapporte les circonstances
de la composition de l’
Air sur trois notes
dans les termes suivants :
« Rousseau affirmait un jour, en plaidant pour la simplification de la musique de
chant, que le compositeur d’une chanson devait se limiter à 4 ou 5 notes au maxi-
mum. On trouvait cela plus que paradoxal : ridicule. Alors Rousseau s’assit, et com-
posa sur trois notes une petite chanson extrêmement touchante. »
55
Le moment est alors venu de se demander à quoi tient l’unité de la « musique
nègre » telle que Schaeffner l’a postulée et mise au jour. On a déjà évoqué le trai-
tement du son ; il faudrait ajouter « l’éternelle lutte […] entre la mesure et le
rythme »
56
, et bien d’autres éléments encore. Mais, d’une certaine façon, là n’est
pas l’essentiel, c’est-à-dire que là n’est pas l’essence de cette musique. À bien lire
(relire) Schaeffner, l’essentiel tient en un mot, une notion, qui ne relève pas a
priori exclusivement du musical. On l’aura deviné, c’est celle de
simplicité
.
Complétons tel fragment que nous avons cité plus haut :
« Des musiques violentes d’Afrique aux chants des planteurs des Antilles ou de la
Louisiane, aux
spirituals
, au
jazz
enfin, il ne s’agit jamais que d’un même fait musical,
sous des aspects étrangement peu variés : un bagage d’expression réduit au minimum,
d’une simplification inquiétante même, et qui n’en aura pas moins servi à la conquête
de trois continents. »
57
Plus loin, avec une exactitude philologique plus grande – car ce terme de « sim-
plification », du fait de son suffixe est assez étonnant – Schaeffner
58
répète :
« Depuis toujours le nègre avait pratiqué cette musique réduite à l’essence, mais il fal-
lait que notre art occidental fût d’abord saturé d’harmonie et d’orchestre pour que
celui-ci passât, d’accord avec le jazz, à l’extrême opposé et pour qu’ainsi la musique
pût reprendre un nouveau départ. »
59
La leçon de Schaeffner (un lecteur de Rousseau, bien sûr) rejoint, par delà les
siècles, le sentiment rousseauiste de la simplicité comme puissance critique.
54.
OC
, I : 1045.
55. Cité par D. Paquette, 1996, art. cit. : 171-172. Voir aussi, à propos des
Airs pour être joués la troupe
marchant
, cette remarque : « L’auteur des ces petits Airs ne présume pas qu’une musique aussi simple
puisse être goûtée. »
56. André Schaeffner,
op
.
cit
., 1988 : 63.
57.
Ibid
. : 14.
58. Nous disons « Schaeffner » car si les chapitres conclusifs XIV, XV, XVI de la première édition de l’ou-
vrage
Le Jazz
sont réputés avoir été écrits par André Cœuroy (voir Lucien Malson, 1988, art. cit. : 153)
et si, de fait, la reprise de l’étude de Schaeffner dans les
Cahiers du Jazz
en 1965 laissait ces chapitres de
côté, le feuilleton du
Ménestrel
, que le volume
Le Jazz
ne fait que reprendre et qui est signé du seul nom
d’André Schaeffner, s’achève précisément sur ces lignes que nous citons et dans lesquelles le style du
musicologue est par ailleurs reconnaissable. Voir les
Notes sur la musique des Afro-Américains
, dans le
Ménestrel
du 25 juin, du 2, 9, 16, 23, 30 juillet et du 6 août 1926.
59. André Schaeffner,
op
.
cit
., 1988 : 111.
Anne-Marie Mercier-Faivre & Yannick Seité
Critique esthétique, bien sûr mais aussi critique politique. Mais cette question
politique – comme celle, bien compliquée, d’une « simplicité » sur les termes de
laquelle il conviendrait de s’entendre, d’ailleurs
60
– ne pourra être l’objet que
d’une autre aventure
61
. Reste que se trouve levé, du moins nous l’espérons, le
paradoxe dont nous avons plus haut mis en place les termes et que le titre de
notre étude s’essayait déjà à annoncer : nègre, la chanson de Rousseau ne l’est pas
d’abord par son créole, elle l’est par sa simplicité . Mais alors, la radicalité de sa
simplicité la fait soudain nègre absolument.
51
MOTS CLÉS/
KEYWORDS :
ethnomusicologie/
ethnomusicology
– Jean-Jacques Rousseau –
Lumières/
Enlightenment
– sauvages/
savages
– jazz
.
60. Rien de moins simple que les polyrythmies africaines et si les tout premiers « jazz bands » à s’être
fait entendre en Europe pratiquaient de fait une musique rustique, mettre le doigt sur la simplicité de la
polyphonie néo-orléanaise pratiquée par le Creole Jazz Band de King Oliver n’est pas une entreprise
simple – pour ne rien dire des arrangements d’un Fletcher Henderson ou des compositions d’un Duke
Ellington encore dans les limbes.
61. Sans détailler ce qui devra faire l’objet d’une autre enquête, ni faire référence à ces formes de com-
plexité musicale liées à l’orchestration ou à l’écriture et auxquelles la note précédente fait allusion, on aura
compris que la simplicité visée tant par Schaeffner que par son maître Rousseau n’est pas autre chose
qu’une complexité qui a changé son point d’application. La complexité ne réside plus dans le genre pra-
tiqué (Rousseau troque la forme opératique pour la romance) mais, par exemple, dans une matière sonore
travaillée dans des sens auparavant inouïs dans des salles de concert. Alors, le moment de la création n’est
plus ou plus seulement celui de l’écriture ; il est celui de l’interprétation. Dans les
Confessions
(
OC
, I:
11), Rousseau attribue sa « passion pour la musique » à sa tante Suson qui lui tint lieu de mère et « savoit
une quantité prodigieuse d’airs et de chansons qu’elle chantoit avec un filet de voix fort doux ». Il pré-
cise : « je me surprends quelquefois à pleurer comme un enfant en marmotant ces petits airs d’une voix
déja cassée et tremblante ». S’il n’est peut-être pas le premier homme au monde à avoir été touché par les
brisures et les tremblements d’une voix qui chante, Rousseau est le premier a avoir
écrit,
mais aussi fourni
les moyens de penser le charme de ce que toute la tradition académique européenne révoque comme des
défauts. Il a fallu attendre le jazz pour que triomphe une musique qui, comme celles aimées de Rousseau
(souhaitées par lui, plutôt), fût, dans certaines de ses manifestations, la musique même de l’
accent
.
Jean-Jacques Rousseau et le jazz
RÉSUMÉ/
ABSTRACT
52
Anne-Marie Mercier-Faivre &Yannick Seité,
Le
jazz à la lumière de Jean-Jacques Rousseau.
—
Le discours tenu sur le jazz par les premiers
témoins (journalistes, écrivains, musico-
logues…) de son arrivée en Europe est extrê-
mement proche de celui, qu’à l’Âge classique,
les voyageurs et les philosophes qui compi-
lèrent les récits de ces derniers produisirent
à propos de la musique des Noirs africains
ou des esclaves. Si on déplore très générale-
ment le bruit et la cacophonie engendrés
par des pratiques qu’il est presque impossible
de tenir pour musicales, quelques voix
s’avèrent plus inspirées. Or, quoi de vérita-
blement commun entre les « tambours des
Mandingos » ou le « chant du Nègre Arada »
d’une part, la musique délivrée dans l’Europe
de l’après Première Guerre mondiale par
les grands orchestres de Will Marion Cook
ou James Reese Europe de l’autre ? Tout en
interrogeant une permanence des discours
que la différence des musiques rend problé-
matique, on suggérera que c’est peut-être
l’activité de penseurs des Lumières tels que
Jean-Jacques Rousseau qui, en posant les
bases de l’ethnomusicologie, a lointainement
préparé nos esprits et nos oreilles à
entendre
les musiques autres ou, plus largement, à
écouter autrement la musique.
Anne-Marie Mercier-Faivre andYannick Seité,
Jazz in the Light of Jean-Jacques Rousseau.
—
Firsthand reports written about jazz, when it
arrived in Europe, by journalists, writers and
musicologists closely resemble the accounts
written, during the Classical Age, about
Black African or slave music by travelers and
the philosophers who set their words down
in writing. Besides general lamentations
about the noise and cacophony produced by
practices that could hardly be called musical,
a few more inspired voices were heard. What
is really in common between « Manding
drums » or the « Nègre Arada chant » and the
music brought to Europe after the First
World War by Will Marion Cook’s or James
Reese’s bands ? While inquiring into the
constancy in these accounts, which does not
hold up given the difference between the
sorts of music in question, the authors sug-
gest that thinkers during the Enlightenment,
such as Jean-Jacques Rousseau (who laid the
basis for ethnomusicology), helped prepare
our minds and ears for other kinds of music
or, in broader terms, prepared the way for us
to listen to music in another way.
