L’articulation du narratif dans la
première promenade
des
Rêveries de Jean Jacques
Rousseau.
Nous nous proposons
d’approcher dans ce modeste travail la première Promenade des « Rêveries du promeneur solitaire » de
J.-J.Rousseau. Pour ce faire, nous avons adopté les outils d’analyse de la
sémiotique greimassienne. Celle-ci se veut une lecture immanente approchant le
texte dans son fonctionnement interne, et loin de toutes les considérations
contextuelles (l’époque de l’auteur et sa biographie par
exemple).
Ce travail est
censé mettre en exergue l’articulation des séquences textuelles constitutives de
la première Promenade.. Ceci passe
obligatoirement par un découpage rigoureux des segments textuels afin
d’expliciter leur organisation comme pratique signifiante et leur agencement
structurel.
Sans chercher
à nier le bien-fondé des
critiques qui contestent la pertinence de quelques concepts
opératoires de la sémiotique, nous disons simplement que l’approche systémique
nous permet d’expliciter l’organisation du texte loin des considérations
idéologiques, sociologiques ou psychologiques.
Reprocher à la
critique sémiotique qui s’attarde sur l’immanence du texte de s’intéresser
principalement à sa signifiance, revient à
contester les modalités de la lecture voire de l’écriture, surtout que la
sémiotique met l’accent essentiellement et avant tout sur le préalable
dictionnairique comme condition première à l’intelligibilité des textes. Si on
ne peut incontestablement nier cet aspect méthodologique et épistémologique, on
ne peut toutefois nier la relativité consubstantielle à tout travail de
recherche. Cela indique pertinemment que la méthode que nous avons élue peut
donner lieu à un débat qui peut confronter le lexicographique au
textuel.
Nous avons
intitulé notre travail l’articulation du narratif et non l’articulation
narrative pour contourner le systématique de la lecture qui suit l’organisation hiérarchique du
texte, en nous appuyant sur la conception que l’on a de l’axe génératif. Cette
tentative de contournement provient de la stratégie adoptée lors de
l ‘analyse, car nous avons
choisi de nous appuyer sur la linéarité des segments qui peut dévoiler la
dynamique du texte dans sa syntagmatique, en plus de son arrangement inhérent à
un élément élémentaire de la signification. Cette démarche qui a été appliquée
par Greimas dans Maupassant et par Roland Barthes dans son analyse des
lexies d’une nouvelle d’Edgar Poe, nous
permet de cerner non seulement la narrativité de la Promenade mais en plus la
mise en récit et la mise en discours des éléments de la textualité. Là encore, il faut faire la différence
entre l’articulation du narratif et l’articulation narrative : dans le
premier cas, il s’agit d’un univers macro-générique concomitant avec d’autres
univers dans chaque texte, alors que le deuxième renvoie à un niveau d’analyse.
Si nous nous étions borné à ce niveau, l’approche serait réductrice et donc
défaillante méthodologiquement.
Il faut
constater qu’il existe un flot de critiques approchant les
Promenades de Rousseau en les rapportant
à leur contexte d’apparition ou de consommation. En réalité, ce n’est pas tant
la rareté – à notre connaissance - des approches systémiques des
Promenades que l’abondance
d’autres consacrées à des genres plus maniables comme le conte et la fable pour
la lecture sémiotique qu’il faut rappeler ici. On peut néanmoins affirmer que ce
travail demeure une entreprise qui peut montrer la faisabilité des concepts
opératoires de la sémiotique.
Notre étude se
focalisera tout particulièrement sur l’articulation du narratif. Une remarque
sans doute évidente, mais qui n’en demeure pas moins très importante s’impose
tout d’abord : nous n’allons pas retracer tous les éléments de l’axe
génératif.
Nous allons
commencer par analyser l’unité introductive de la Promenade. Notre but premier serait de déterminer le statut
fonctionnel de l’incipit et sa
fonction textuelle. Pour ce faire nous nous sommes penchés sur l'examen des
lexèmes constitutifs de la première phrase de la Promenade. Il ne fait guère de doute que l’on doit tenter de
saisir le fonctionnement énoncif mais aussi énonciatif de la phrase initiale de
la Promenade d’autant plus que
l’incipit débute par un embrayage
actoriel.
Des questions
capitales doivent être inévitablement posées à ce propos : Quel est le
statut textuel et paratextuel de l’incipit ? Quelle est la fonction du « je »
(mis en avant textuellement) dans la narration selon le modèle actantiel ?
Quelle est la position de ce même « je » dans l’énonciation (le
débrayage et l’embrayage).? Y a t-il
les marques de l’ancrage de l’être biographique dans la
Promenade? Quelle est la distance
entre le « je » biographique et le « je » fictionnel ?
La référence aux Confessions et
aux Dialogues peut-elle être vue
et lue comme un indice d’une écriture autobiographique ? Autant
d’interrogations qui en définitif peuvent se résumer en celle-ci : quelle
est la fonction textuelle et discursive de
l’incipit ?
Notre étude
s’attachera donc à exposer en premier lieu comment le narratif se manifeste dans
des niveaux différents. Il faudra alors nous demander si l’organisation
textuelle de la Promenade dévoile un
arrangement discursif stratégique. Nous adopterons pour cela un point de
vue qui s’ouvre sur le problème de l’énonciation comme celui agréé par Joseph
Courtés. Un autre impératif guidera notre travail : c’est celui qui nous
pousse à considérer la texture apparente de la Promenade comme un des éléments fondamentaux de la pratique
signifiante.
Nous avons été
confronté à ces problèmes majeurs. Nous pouvons situer ces problèmes dans deux
niveaux, les uns concernent le
corpus, et les autres la démarche.
Pour ce qui est du corpus, signalons que nous n’avons pas trouvé d’analyses
sémiotiques, et pour ce qui est de la démarche, il est incontestable que les
Promenades de Rousseau sont condensées au
niveau sémantique.
A ces
problèmes d’ordre spécifique s’ajoutent les écueils qui émanent de la nature
même de la recherche comme aventure, étant donné que toute étude est confrontée
généralement au manque de référence bibliographique.
1. Le statut énoncif et énonciatif de
l’incipit de la
Promenade :
1.1. Le
statut fonctionnel de l’incipit:
Si l’on
applique à la première Promenade de
J-J.Rousseau la grille proposée par Andréa Del Lungo dans son essai de
classification et d'explication des incipits romanesques², on peut dégager quelques réflexions.
Nous pouvons également comprendre la stratégie de communication avec le lecteur.
Pour Del Lungo
un doit remplir cinq fonctions[1] :
1 – justifier la prise de parole = fonction légitimante.
2 - Commencer le texte = fonction
codifiante.
3- Intéresser le lecteur = fonction séductive.
4- Mettre
en scène la fiction = fonction informative.
5-
Mettre en scène l’histoire = fonction dramatique.
La toute
première ligne nous introduit dans le texte, mais aussi dans l’univers
thématique de la Promenade (la solitude). Ceci peut correspondre à la
fonction légitimante. Mais la solitude comme thématique prépondérante
textuellement montre un paradoxe de l’écriture ; comment en effet prétendre
une disjonction totale avec la société, toute en opérant une conjonction par le
biais de l’écriture ? La
légitimation de l’écriture est explicitée par le segment suivant
:
« Mais je comptais encore
sur l'avenir, et j'espérais qu'une génération meilleure, examinant mieux et les
jugements portés par celle- ci sur mon compte et sa conduite avec moi démêlerait
aisément l'artifice de ceux qui la dirigent et me verrait encore tel que je
suis. C'est cet espoir qui m'a fait écrire mes Dialogues, et qui m'a suggéré mille folles
tentatives pour les faire passer à la postérité.. » [2]
Nous constatons dans ce segment que les
Promenades ont le statut d’une
œuvre définie selon l’intentio auctoris par son devenir et non par ce qu’elle peut
engendrer comme réaction. Cette légitimation justificatrice peut être examinée
d’après les données de la sémiotique des passions. Il suffit de lire cette
séquence pour voir la complexité du parcours pathémique :
« Cet espoir quoique
éloigné, tenait mon âme dans la même agitation que quand je cherchais encore
dans le siècle un cœur juste, et mes espérances que j'avais beau jeter au loin
me rendaient également le jouet des hommes d'aujourd'hui. J'ai dit dans mes
Dialogues sur quoi je fondais cette attente. Je me trompais. Je l'ai senti par
bonheur assez à temps pour trouver encore avant ma dernière heure un intervalle
de pleine quiétude et de repos absolu. Cet intervalle a commencé à l'époque dont
je parle, et j'ai lieu de croire qu'il ne sera plus interrompu. » [3]
De par sa position dans la texture
de surface, l’incipit est élément
prééminent dans l’encodage énonciatif. Il institue par conséquent une
fonction codifiante relative
à la manière avec laquelle il faut
approcher le texte. Le premier lexème est un embrayeur qui classe la
Promenade dans un type de
discours plutôt que dans un autre. Citons à ce propos Jaques Le Gall :
« La codification se construit
autour de références voire d’inférences, telles une citation, un nom d’auteur,
une allusion, ou tout autre embrayeur susceptible d’orienter la réception,
c’est-à-dire d’ouvrir un horizon d’attente » [4]
La
fonction légitimante peut interférer sur le
parcours de séduction déclenché par l’acte d’écriture même. Mais sans altérer sa
dimension volitive en dépit de la nature du contrat qui unit le producteur de
l’énoncé et son consommateur. Ceci apparaît dans les stratégies érigées dans
l’acte d’écriture. Il apparaît aussi dans le maniement conscient et usuellement
esthétique de la langue. La solitude sociale peut être accentuée par une
solitude plus profonde qui résulte d’un échec dans l’écriture. Pour le sujet écrivant cette expérience
devient une tentative de refaire ce qui a « été brisé ».
Par sa dimension
informative,
l’incipit assure au texte sa
lisibilité. Il lui assure aussi son intelligibilité. L’intelligibilité du texte
permet de le concevoir comme une histoire qui ne narre pas toujours une
histoire. En conséquence, il réclame une mise en marche du discours comme une
énonciation qui peut révéler la stratégie textuelle selon l’approche génétique
et une stratégie discursive mettant en scène la fabula de l’écriture.
1.2.
Le statut énonciatif de l’incipit de la
Promenade
:
Bien que très
simple, la question « comment ou par où commencer ? » ne fut
qu’assez tardivement posée[5].
C’est Aragon qui officia et avalisa l’incipit comme élément paratextuel qui peut remanier le débat
à propos du statut des seuils qui cadrent le texte. L’approche génétique quant à
elle était pionnière « en déplaçant l’interrogation critique de l’auteur
vers l’écrivain, de l’écrit vers l’écriture, de la structure vers les processus,
de l’œuvre vers sa genèse. »[6]
et en concevant la configuration finale d’une œuvre comme une réalisation
progressive au cours de laquelle rédaction n’est que le débouché d’un travail de
documentation, de collecte d’informations, de conception et rectification.
L’apport de la critique génétique quant à l’incipit apparaît dans l’attention accordée aux deux types
d’étapes prérédactionnelles[7]
du processus d’écriture c’est-à-dire l’étape exploratoire «préinitiale»
(documentation, détermination du projet), et l’étape de décisionnelle qui
précède aussitôt la rédaction et
qui constitue la mise en route du projet. Notons à propos de la phase
prérédactionnelle que :
« Chez
Aragon, le travail préliminaire sur l’incipit du récit joue à lui seul le rôle de phase initiale en
télescopant la décision, la programmation et le début de la réalisation. Chez
Giono, la phase d’exploration et de décision se concentre dans l’invention du
titre, la rédaction servant ensuite à l’élucider. »[8]
Il serait donc productif
de concevoir l’incipit comme un élément
textuel pouvant être envisagé comme le seuil du texte, si l’on prend en
considération la définition que lui a donnée Andréa Del Lungo
:
« Frontière
décisive de l’œuvre, seuil à double sens entre le monde et le texte, instant fatidique de
rencontre des désirs de l’écrivain et des attentes du lecteur »[9]
L’incipit comme frontière est exprimé dans la phrase
introductive du conte et des conteurs «Il était une fois». Il n’est donc pas
tendancieux et abusif d’affirmer que ce seuil témoigne d’une rupture et d’une
localisation comme il est indiqué dans ce schéma :

Seul des oppositions
situées à des niveaux différents peuvent manifester la rupture et la
localisation occasionnées par l’incipit. Il ne fait aucun doute
que l’exorde d’un texte est une borne démarcative et localisatrice fonctionnant
à des niveaux différents :
|
|
La
rupture |
La
localisation |
|
Niveau
Temporel |
avant vs
après |
Pendant |
|
Niveau spatial
|
ici vs
ailleurs |
Là |
|
Niveau
existentiel |
absence vs
présence |
Etre |
|
Niveau scriptural
|
blanc vs
texte |
Ecrit |
|
Niveau phonétique
|
Silence vs parole
|
verbe |
Admettons donc qu’à
titre de médiation entre le texte et son lecteur, entre le destinataire et le
destinateur ou entre le narrateur et le narrataire, l’incipit se révèle investi
des marques de la relation qui unit
l’auteur à son public.
Pour ce qui est de la Promenade que nous nous proposons d’étudier, deux raisons nous
ont poussé d’approcher cet élément, l’une est générale et systématique l’autre
est plus spécifique et particulièrement ancrée dans notre
corpus car :
1-Etant un élément textuel, l’incipit (im)pose son statut énoncif et énonciatif comme une
systématique qui ne sort pas d’une programmation globale du texte, du fait que
tout texte ne peut être que anaphorisation ou cataphorisation, même s’il tente
de s’organiser dans certains cas selon une rupture thématique, explicite et
intentionnelle (récit dégénéré, et fragmentaire par
exemple).
2-Et étant un
élément du discours, l’incipit est au fonctionnement spécifique de texte et à sa
dynamique interne. C’est la structure distinctive qui construit donc l’univers
pathémique et les parcours figuratifs et thématiques.
Le
« Je » se trouve dans une situation dégradée, si nous concevons la
socialité comme indice de normalité. Et
pour marquer cette situation, il fait appel à un registre pathétique, ce
récit de moi est un discours lyrique, car on y trouve des marques de
subjectivité, qui fait que le moment d’écriture soit continu.
Comme
introduction d’un récit du moi, l’incipit s’ouvre sur une marque de
l’énonciation qui est le «Me ». Une question capitale s’impose : de
quelle corrélation s’agit-il ?
De la corrélation de personnalité
ou celle de la subjectivité ?

Tout en affirmant que
le « je » désigne ici
Jean Jacques Rousseau l’auteur des Promenades et énonciateur, on peut parler de «narrateur » du
récit. En nous appuyant sur tous
les segments de la Promenade, il nous est possible d’admettre qu’il est question
de corrélation de la personnalité.

Le segment introductif
de la Promenade, et qui nous pousse à
nous interroger sur la corrélation,
est le suivant : «Me voici donc seul sur la terre, n’ayant plus de
frère, d’ami, de société que moi-même. »
[10].
Dans ce segment textuel,
on relève les embrayeurs : « voici » et « me » qui
renvoient à la situation de l’énonciation. Ce «me » représente une présence
forte de l’énonciateur. La réunion de ces termes, montre bien la position qui
confronte une spatialité et une temporalité mais aussi une subjectivité
indéterminée. On ne peut que remarquer tout au long de la
Promenade le grand nombre des
marques de l ‘énonciation telles que «me », «moi »,
«je ».
Admettons avec Courtés
qu’ :« A l’opération de débrayage, qui assure le passage de l’insistance de
l’énonciation à celle de l’énoncé, répond, en ce sens inverse, la procédure dite
d’embrayage qui vise le retour à l ’instance de l’énonciation »[11].
A vrai dire, ce retour est absolument impossible : si l’on revenait, en
effet à l’instance de l’énonciation, l ’énoncé disparaîtrait. Ceci dit, un
embrayage partiel est impossible.

Signalons d’abord que «Me voici » n’a donc de sens comme ancrage
(temporel, spatial et actoriel) que
par rapport à deux types de structures : les structures sémio-narratives
que nous tenterons d’approcher dans le deuxième chapitre et les structures
discursives. Cela veut dire qu’en se localisant dans un ou plusieurs segments de
la durée (la temporalité), et de l’étendue (la spatialité) et en se positionnant
dans des structures polémico-contractuelles que le «Me voici » prend sens.
Cette désignation actorielle et spatiale est le simulacre d’une performance
visant un rôle thématique au niveau syntaxique et au niveau morphologique. Il
est aussi la prise en charge d’un positionnement dans une structure
prédictoire.
![]() Passif (agent).
Passif (agent).
Le «Me » va assurer le rôle du sujet
Actif (patient).
Le caractère
rétrospectif de la narration et son inscription dans la sphère de la
subjectivité dévoilent une complexité narrative, nous avons ces trois entités
(narrateur-actant/acteur-auteur), ce qui donne encore une complexité dans le schéma
actantiel .En effet, la rétrospection
dans la narration manifeste un va-et-vient constant entre le temps du
récit et celui de la narration. Ainsi, on peut parler de régression énonciative.
 AtN[12]
AtN[12]
Atn[13]
Distance entre Atn et AtN
Quand on prend le texte dans sa
littéralité il évoque un ici ou
s’ancre le sujet, mais dans la profondeur du texte (discours), c’est un
ailleurs qui ne se détermine que par les autres segments textuels.
Résumons cela
en disant que :
-
«Voici », marque la prise en charge d’un positionnement d’une structure
prédictoire.
-
« Donc », va favoriser une lecture de la temporalité et de la
spatialité conséquence, mais en le favorisant, il relativise sa
pertinence.
- «Seul sur la
terre », renvoie à la disjonction dans l’espace.
1.2.1 :
L’embrayage actoriel :
Le “je” se trouve dans une situation où l’écriture assurer la médiation, entre l’auteur et le
lecteur ou ce qu’on préfère appeler : énonciateur et énonciataire ;
l’énoncé est le produit d’un acte
qui est l’énonciation, les
deux actants du programme narratif : énonciateur et énonciataire, étant,
virtuels, présupposés
logiquement :
« …L’énonciation est un acte, une opération, et,
comme telle, elle est assimilable-dans son ordre et à son niveau- à un
programme narratif déterminé qui
met en jeu trois actants.
Indépendamment du /faire/ qui s’identifie ici évidemment
à l’acte même de l’énonciation nous avons un sujet de faire(=S1) ou «sujet
énonciateur » (J-C.Coquet), auquel nous réserverons désormais le nom
d’énonciateur, l’objet(=O) en circulation correspond à ce qui est énoncé, à
l’énoncé donc ; le troisième actant en lice est naturellement le sujet à
qui s’adresse l’énoncé, qui en est le bénéficiaire(=S2) : nous l’appelons
énonciataire. »[14]
Ainsi, le programme narratif de cet acte, proposé par
Courtès, est comme suit :
![]() F ⌠ S1
(S2 ∩ O)
⌡
F ⌠ S1
(S2 ∩ O)
⌡
énonciation
énonciateur
énonciataire
énoncé
Dans un énoncé, les pronoms personnels, tels que “je”, “nous”, “tu” et
autres, sont certes des marques de l’énonciation, mais ils ne renvoient pas
toujours au couple: énonciateur/énonciataire, puisque l’énoncé est déjà
produit.
Dés lors,
Courtès fait la distinction entre les deux composantes de
l’énonciation:
 |
énoncé
Oŭ: Le narré est «l’énoncé
énoncé ».
La
façon de présenter ce narré est l’énonciation énoncée.
Rappelons
que la sémiotique greimassienne
rejetait au début par le principe de l’immanence (on est obligé par ce principe
de rester dans le texte) ; le sujet énonciateur, mais a finit par accepter d’enrichir cette
théorie par aborder les problèmes
relatifs à l’énonciation .
Greimas, lui-même affirme :
« On doit chercher à déterminer le statut et le
mode d’existence du sujet de l’énonciation. L’impossibilité ou" nous trouvons de parler, en
sémiotique, tout court, sans le concevoir nécessairement comme faisant partie de
la structure logico-grammaticale de l’énonciation dont il est l’actant sujet,
montre à la fois les limites dans lesquelles s’enferme de parti pris notre réflexion
sémiotique et le cadre théorique duquel son statut peut être précisé. Ou bien
l’énonciation est un acte performateur non linguistique et échappe, comme tel, à
la compétence du sémioticien, ou bien elle est présente d’une manière ou d’une
autre-comme présupposé implicite dans le texte par exemple -, et alors
l’énonciation peut être formulé comme un énoncé d’un type particulier, c’est à
dire comme un «énoncé dit énonciation » parce qu’il comporte un autre
énoncé au titre de son actant-sujet, et dés lors elle se trouve réintégrée dans
la réflexion sémiotique qui cherchera à définir le statut sémantique et
grammatical de son sujet »[15]
La
Promenade commence par le
marqueur « Me » qui engage le lecteur dans un contrat énonciatif donnant lieu à une stratégie spécifique de la
réception, vu que cet élément crée une (des) hypothèse(s) de lecture, tout
en écartant d’autres, surtout si nous concevons avec Bakhtine
que : « Toute œuvre littéraire est tournée en dehors,
non
vers elle, mais vers l’auditeur-lecteur, […] elle anticipe en une certaine
mesure, ses réactions éventuelles ».[16]
La prédominance
textuelle place la Promenade dans un espace d’échange selon une relation
intersubjective. Ceci est confirmé par l’organisation du texte autour de la
corrélation de l’identité « je® il ». Alors, il
faut dire que :
«a-Entre discours à
transmettre (discours cité) et discours servant à la transmission (discours
citant), il existe ce rapport d’appréhension du discours d’autrui si bien analysé par
Volochinov.
b-Deux autres stratégies
énonciatives, mêlées étroitement selon les moments du récit(mêlées aussi au
troisième type d’énonciation), retenons
que l’énonciation historique (dans laquelle il
n’y a plus de narrateur, mais seulement une fonction narrative) comme
l’énonciation du discours, sont des traces des
réglages interactifs du discours.
c-A’ la base de toute
communication narrative, il faut postuler un contrat énonciatif
dans un réseau de places (
institutionnelles et locutives) et de relations. Par contrat, entendons aussi
les conventions discursives et l’accord des interlocuteurs (sur la base du savoir
partagé implicite et du choix d’un niveau d’intelligibilité) que les
affrontements persuasifs (au faire croire de
l’énonciateur correspond le faire
interprétatif de l’énonciataire)[17]
Si nous passons de la
stratégie énonciative proprement dite· à l’énonciation
énoncée, nous serons confrontés à deux actants de
l’énoncé.
Le «Me » qui
est mis en avant textuellement s’identifie avec un acteur engagé dans l’action
du moment où il se positionne dans l’acte narratif «Me voici donc
seul » qui présuppose une situation opposée avant l’accomplissement d’une
performance. Il y a là une identification entre l’actant de l’énonciation /la
narration et l’acteur de l’énoncé/le narré.
Une autre identification peut être
discernée, elle réunit le je biographique et le je embrayeur : L’acteur
référentiel et l’acteur
fictionnel
Nous sommes donc
confrontés à deux univers : biographique et
fictionnel :
 |
Cette confusion entre
deux univers différents donne un aspect hétérogène à la Promenade quant à sa
visée. Nous pouvons représenter le schéma de Nadine Gélas à propos de la
fonction pragmatique du récit :

Produire un texte
autobiographique
c’est persuader /dissuader
L’introduction
à un récit centré sur le moi, par le «Me », insiste sur le fait que ce
«moi », est l’objet de la Promenade
et du récit qui la raconte, le sujet est bien aisé à déterminer son statut, le sentiment
d’existence est marqué par ce pronom « me ». Cela fait de lui un être actif. Le
« je » de la Promenade
est donc à mi-chemin entre le personnage-référentiel et le personnage-embrayeur [18]
1.2.2. L’embrayage
spatial et temporel:
Parce qu’il y a
l’absence d’indices temporels et aspectuels renvoyant à un segment temporel ou à
une position syntaxe de la narrativité, l’incipit place la temporalité en
suspense. Car tout en indiquant la temporalité qui de prime à bord indique la conséquence,
le «donc » fait écran de /par l’absence de chrononyme dans la phrase
introductive..
Cette indétermination
donne la possibilité de situer ce
«voici donc ». La logique des possibilités narratives de Bremond pour nous
être utile. Le point de départ est
la reconnaissance de l’aspect narratif de la Promenade après la postulation que la narrativité est un
phénomène reconnaissable grâce au
processus pragmatique (au sens général.). En reprenant le schéma logique qui retrace
la linéarité du récit et englobe l’enchaînement des fonctions. Nous pouvons
situer le segment épisodique de l’incipit dans toutes les phases
fonctionnelles de la réalisation des séries que l’on peut représenter comme
suit :
Série 1
Série 2
 1:[1]
fonction initiale
1:[1]
fonction initiale
12 : fonction
initiale
2[1] :
processus de réalisation
22 : fonction
médiane
32 : fonction terminale
31: fonction terminale·
La séquence narrative
peut en effet être située dans la fonction initiale comme dans la fonction
terminale, car l’aspect aspectuel du « donc » n’est déterminé que par
le positionnement dans l’axe de la temporalité.
L’indétermination
temporelle crée un éventail de possibilités quant à la narration mais tout en
plaçant la dégradation comme processus narratif et comme possibilité la plus crédible. Si nous concevons la
solitude un écart par rapport à un schéma vraisemblable et synonyme
d’amélioration. Ce donc peut être placé dans la sphère du prévisible ou de
l’actuel ou du réel. Nous pouvons ainsi exploiter le schéma de Bremond pour
montrer les positions possibles du « je ».
 1.dégradation prévisible
1.dégradation prévisible
2- processus de
dégradation
processus de dégradation
3.dégradation produite
dégradation évitée
Mais cette dégradation
hypothétique ne peut être un état initial de l’amélioration, surtout si nous
admettons que la dégradation relève dans notre texte du
potentiel.
 1:[1]
dégradation potentielle
1:[1]
dégradation potentielle
12 : amélioration à
obtenir.
2[1] :
processus de dégradation
22 :processus d’amélioration
32 : amélioration
obtenue
31: dégradation
évitée
Néanmoins, cette
position dégradée n’exclut pas le processus qui vise l’amélioration.
Concluons que le «Me voici
donc » est
l’embrayage spatial qui détermine unposition abstraite car
il ne réfère pas à un segment spatial déterminé, mais à une position dans un
espace qui n’est obligatoirement pas
topographique ou topologique.
2. L’articulation narrative et
thématique de la Promenade :
Ce texte que l’on
pourrait insérer dans le genre de la Promenade, invente une nouvelle
forme d’écriture (l’hétérogénéité et la complexité de la composition et de la
stratification des instances énonciatives des figures et des thèmes :
argumentation, description et narration, le couple récit/discours). Dès
lors, on peut s’interroger sur la
narrativité et la mise en discours dans sa totalité.
Avec la séquence
narrative, on arrive à relever les séries d’états et de transformations, sur
lesquelles se constitue la logique du récit, mais il importe donc de respecter
chaque niveau, et la succession au
sein de la séquence.
Pour clarifier cela, on
peut représenter les transformations comme suit :
![]() F(S
op)
(SUO)-----------(S∩O)
F(S
op)
(SUO)-----------(S∩O)
Ou’ S op : représente
le rôle du sujet opérateur.
S : représente le rôle
du Sujet d’état.
O : représente le rôle de l’objet (manquant
puis acquis).
U et ∩ représentant les
relations de disjonction et de conjonction entre le Sujet et l’Objet-valeur.
Ainsi, on arrive à
comparer entre Sujet, Objet et mettre en évidence les rapports qu’ils
entretiennent entre eux. Il faut
dire que « le récit s ’ordonne à partir de sa fin en remontant
jusqu’au début. La dernière unité donnée est donc la première
logiquement »[19]
.
La première ligne
prépare une séquence de manipulation : l’état initial du sujet héros,
troublé ainsi par le fait d’être exclu de la société ; et qui dans sa quête
intentionnelle, part de son manque de l’objet désiré, ensuite, succède
l’incompréhension, la rupture, et l’indignation de ce héros, un manque est
ressenti par le sujet héros, et par une sorte d’accord, il commence à écrire
pour combler ce manque. De ce fait, le sujet d’état passe d’une disjonction
initiale à une conjonction finale.
![]() PN==
F(S2)
⌠( S1 U O )
(S1∩ O)⌡ [20]
PN==
F(S2)
⌠( S1 U O )
(S1∩ O)⌡ [20]
Cette transformation
peut engendrer un programme qui est « la structure syntaxique
élémentaire qui met en musique le paradigme actantiel, à travers la relation
entre le sujet et l’objet, érigés ainsi en hypers-actants…Le concept sémiotique
de jonction définit cette double relation élémentaire : conjonction et
disjonction. »[21]
Au terme de la
manipulation, on constate une tension lors de la réalisation future du
contrat.
Dans la séquence
d’acquisition de la compétence, le sujet compétent acquiert l’écriture comme
moyen de nouer ce qu’a été brisé, en d’autres termes, combler le
manque.
La séquence performance
s’accomplit une fois le héros triomphe en arrivant au terme de l’épreuve
principale: « En dépit des hommes, je saurais goûter encore le charme de la
société » [22].
Dans ce segment
textuel, on ne peut relever sans
ambiguïté la phase de sanction, en
raison de la quête même de l’objet qui semble être contractuelle et polémique à
la fois, on constate alors, une satisfaction ultérieure de ses besoins, là où on
touche un intérêt « égocentrique ».
Rappelons bien sûr que
le sujet compétent et le sujet performant ne sont qu’un et ne forment qu’un
sujet à des phases différentes de la séquence narrative.
«Ils ont cherché dans les raffinements de
leur haine quel tourment pouvait être le plus cruel à mon âme sensible, et ils
ont brisé tous les liens qui m’attachaient à eux » [23]
L’articulation narrative
et l’aspect hiérarchique des deux niveaux donnent un sens à la quête
introspective qui déborde la schématisation littérale du faire, étant donné que
le faire conjonctif de S2 par rapport à O1( le tourment cruel) est enchâssé par
le vouloir modalisateur du faire. La conjonction de S2 avec l’objet n’est qu’une
phase initiale visant la conjonction de S1 avec le même
objet.
«Il » est à la quête du
«tourment cruel », à la réalisation de cette quête, ils ont brisé les
liens, on peut schématiser comme
ceci :
S2 ⌠(S2
U O1)
(S2 ∩ O1)⌡
(S2 U S1) la logique
(S2
U S1)
« ils ont brisé les
liens »
F(s)
⌠(S2 ∩ O2)
(S2 UO2)⌡
S1 : je.
O1 : le tourment
cruel.
S2 : ils.
O2 :
l’affection
L’objet de la quête est
le tourment cruel, par sa
focalisation spatiale par rapport au sujet opérateur, il nécessite, pour la
réussite de l’épreuve un faire réflexif (au niveau
cognitif-introspectif-) et un faire transitif au niveau
pragmatique.
La disjonction (S2 U O2), n’est
qu’une implication logique qui n’exclut pas son contraire. La dernière
transformation n’est par conséquent, qu’une formulation hypothétique :
c’est la raison pour laquelle, il faut approcher le parcours de dégradation
selon l’agent de patient du faire .
![]() F(S1)
⌠(S1 U O1)
(S1∩ O1)⌡
F(S1)
⌠(S1 U O1)
(S1∩ O1)⌡
F(S2)
⌠(S2 ∩ O1)
(S2 U O1)⌡
![]()
(S1 U S2)
La disjonction du S1
avec S2 peut apparaître, si l’on se réfère
à l’aspect du faire, «ils ont brisé violemment » «ils n’ont pu
qu’en cessant de l’être se dérober à mon affection », comme système
dysphorique.
Alors que la visée
pragmatique, cognitive et thymique de S1 démontre le contraire car se disjoindre
de l’autre est une preuve obligatoire et principale de la disjonction avec soi
même.
![]() disjonction
axiologique
conjonction pragmatique, cognitive et thymique.
disjonction
axiologique
conjonction pragmatique, cognitive et thymique.
Dans l’exercice du
faire persuasif, les actants visent un
statut sémiotique en objectivisant les positions inter-actantielles, de fait,
les sujets mis en relation par le contrat, hiérarchisent les pôles et les
positions au niveau discursif.
|
Niveau
cognitif |
F
(S2)
⌠ (S2 U O1) (S2 ∩ O1)⌡ |
|
Niveau
persuasif |
F
(S2)
⌠ (S1 U O1 ) (S1 ∩
O1)⌡ |
Les
parcours narratifs ne donnent aucun indice, sur la relation entre
destinateur/destinataire et le sujet opérateur. Il est donc pertinent
d’approcher la dimension cognitive du récit en mettant en place une structure
qui explicite les positions morphologiques et syntaxiques des actants selon
leurs points de vue comme il apparaît dans la
manipulation :
Manipulation
Point de vue
point de vue
du destinateur
du sujet opérateur
║
║
║
Persuasion
acquisition des valeurs
(faire faire)
modales
S1 ® S1
S1∩S2
2.1. La modalisation de la
quête :
C’est le texte
qui institue l’opposé de la solitude, car cette dernière peut recevoir les
investissements sémantiques différents selon la visée thématique.
«Voilà ce qui me reste à chercher. Malheureusement cette
recherche doit être précédée d’un coup d’œil sur position. » [24]
Ce segment
textuel présente la complexité du programme narratif du «je » (S1), du fait
de l’emboîtement des structures de l’Etre du faire et du Faire-être. Cette
organisation obéit à la logique narrative de la présupposition et de
l’implication.* ;
C’est-à-dire que l’acquisition de la compétence n’est pas une finalité
pragmatique au sens peircien.
D’autre part,
la performance n’est pas l’aboutissement d’un Etre du faire, même, si ce n’est
pas explicite dans le texte par des indices thématiques ou figuratifs. Le
programme narratif d’usage permet de cerner la compétence du sujet opérateur (la
conjonction et la disjonction actualisante), et cela peut être représenté dans
le schéma suivant :

Compte tenu de
la présupposition et de l’implication de l’Etre du faire et du Faire-être, nous
pouvons discerner la complexité du PN. Cette dernière ne réside pas dans la
réalisation de la relation entre le sujet d’état et l’objet, mais dans
l’enchâssement de certains faires narratifs dans les autres, et même dans
l’emboîtement des parcours narratifs réalisés par un seul sujet. Nous sommes
donc amenés à mettre en lumière l’opposition du PN par rapport à un noyau*
central dans le narré, autour duquel pivotent les segments à tous les niveaux de
l’axe génératif.
Signalons aussi que l’objet de la quête est la
conjonction de S1 avec lui-même, une conjonction cognitive et épistémique en
s’objectivant tout en gardant sa continuité matérielle car la conjonction n’est
pas avec une spatialité étrangère.
Il n’est possible d’affirmer que la conjonction ne
concerne pas une spatialité
même si elle est située dans
l’espace et dans le temps. Ainsi, il est possible d’envisager le sujet opérateur
(S1) comme un actant dédoublé dans son existence
sémiotique :
S1
![]()
S1
S’1
Sujet
objet.
Ce même S1 peut désigner un acteur assumant deux
positions actantielles :
Sujet
objet
 S1
S’1
S1
S’1
S1.
Dans la séquence narrative inhérente à la quête, le S1
met en jeu une modalisation virtualisante de la transformation principale que
l’on peut résumer comme un vouloir et/ou un devoir relatif à l’acquisition d’un
objet valeur.
La schématisation pourra dès lors mettre en évidence l’objectivation d’un
sujet qui implique une subjectivation préalable du sujet comme objet (le sujet
comme corporalité et l’objet discontinu et le sujet comme altérité). On peut dés
lors rendre compte de la quête comme réalisation d’un faire
modalisé :
![]() F(S1)
⌠ (S1 U S’1)
(S1 ∩ S1’) ⌡
F(S1)
⌠ (S1 U S’1)
(S1 ∩ S1’) ⌡
S1: sujet.
S’1: objet.
La quête de l’Objet valeur passe par l’accomplissement
d’un faire narratif annexe par rapport à la performance voulue. On est alors
confronté à deux performances, l’une est une performance voulue (le passage
de l’altérité vers l’identité en plus de la conjonction avec l’identité) l’autre
est due (la reconnaissance de la
position et la localisation dans l’espace et dans la société). On peut
schématiser cela de la façon suivante :
 |
P N d’usage
P
N principal
Compétence performance
performance
transformation
transformation
de S1
des états réalisés
(S1Ç
0m)
par S1.
reconnaissance de
(S1Ç
S¢1)
la localisation
ß
ß
(S1 Ç
0)
(S1
Ç
S¢1)
performance
performance
due
voulue
Examinons après cette schématisation le segment
suivant :
“Malheureusement
cette recherche doit être précédée d’un coup d’œil sur ma position. C’est une
idée par laquelle il faut nécessairement que je passe pour arriver d’eux à
moi”[25]
Dans ce segment textuel, la position de Jean Jacques
Rousseau est l’objet de quête principale, le « je » est confronté à
deux parcours narratifs : le premier concerne la quête de soi et le
positionnement par rapport à sa propre identité, cette quête offre des possibilités que l’on
peut expliciter en projetant la conjonction de S1 et la disjonction mais sans que la projection soit un
critère qui dévoile un parcours pathémique .
Le deuxième parcours narratif concerne la quête de S1
par rapport à S2.
F(S1) ------ (S1U S1) ------ (S1∩ S1)⌡
Il y a un enchâssement du pragmatique par rapport au
cognitif. C’est l’idée qui est l’objet de la quête. Le faire traduit la
nécessité d’accomplir une performance.
La connaissance de la position de S1 traduit un vouloir
concernant la localisation dans la spatialité
La «performance due » instaure un investissement sémantique de l’état
et du faire de S1. Etant modalisés, l’état et le faire sont susceptibles d’être
projetés sur le carré sémiotique. La projection de l’état modalisé concerne les catégories modales
aléthiques, que l’on peut
schématiser comme suit:
 Devoir être
devoir ne pas être
Devoir être
devoir ne pas être
(nécessité)
(impossibilité)
ne pas devoir ne pas être
ne pas devoir être
( possibilité)
(contingence)
Et la projection du faire concerne les catégories
modales déontiques :
Devoir faire
devoir ne pas faire
(prescription)
(interdiction)
ne pas devoir ne pas faire
ne pas devoir faire
 (permissivité)
(facultativité)
(permissivité)
(facultativité)
En tant que sujet modalisé comme être et comme faire, S1
peut être placé dans le carré sémiotique, des catégories modales
aléthiques, il serait dans ce cas un
sujet devant être et par conséquent inscrit dans la nécessité.
Il est à signaler que ces segments textuels qui
manifestent la modalisation combinent l’être et le faire, dans la même
organisation mais selon des positions différentes, car on ne peut pas morceler
le sujet en un faire indépendamment de l’être qui le réalise, comme on ne peut en aucun cas
reconnaître un être sans qu’il soit un acteur qui réalise les
faires.
Il n’est cependant pas pertinent d’affirmer en
s’appuyant sur ce principe d’unité entre le pragmatique et le cognitif, que la
modalisation de l’état n’est pas différente de celle de la transformation. Il
est alors nécessaire de déceler la différence entre les deux niveaux modalisés.
Greimas a affirmé : «On peut considérer le
devoir faire, et le devoir
être, deux structures modales identiques, quant à
l’énoncé modalisant qu’elles
comportent et distinguent quant aux énoncés qui sont modalisés » [26]
2.2. La complexité
actantielle :
L’actant est un élément
d’une relation : celle qui lie l’agent à son action : Il désigne donc
une fonction ; comme il apparaît dans l’énoncé narratif simple
(EN=F(A·)[27].
La fonction dont il s’agit ici déborde la conception proppienne qui l’a rapporté
à « l’action d’un personnage défini au point de vue de sa signification
dans le déroulement de l’intrigue »[28]
le modèle actantiel invite donc à regrouper les personnages sous des actants
abstraits ou collectifs pour trouver d'autres niveaux de sens au lieu d’en
rester à l’analyse psychologisante. Il autorise aussi « la réduction
des combinaisons multiples que connaît le récit »[29]
La réduction des
combinaisons du récit est ajoutée à la réduction des personnages conçus dans le
modèle de V.Propp qui : « avait regroupé les dramatis personae
du
conte en une série de sept personnage : Agresseur (méchant), Donateur
(pourvoyeur), Auxiliaire, Princesse (personnage à chercher) et son père,
Mandateur, Héros et Faux-héros.» [30]
La détermination des
couples peut être ainsi :
![]() Sujet
Objet
Sujet
Objet
![]() Destinateur
Destinataire
Destinateur
Destinataire
![]() Adjuvant
Opposant.
Adjuvant
Opposant.
Les couples précédemment
cités s’organisent selon des modalisations spécifiques à chaque
relation.

Le choix du sujet est
extrêmement important, c’est un personnage ou un groupe de personnage, il est
celui dont le désir détermine d’une manière décisive l’action du récit, son
désir est positif.
Un actant désigne un
personnage, il peut être un être humain, un animal, un objet ou un
concept.
Les quatre actants qu’on considère comme principaux
dans le modèle greimassien sont organisés en couple selon leur relation
réciproque : « le modèle actantiel est axé sur l’objet du désiré
par le sujet et situé comme objet de communication , entre le destinateur et le
destinataire. »[31]
Cependant, il est impératif de signaler les dissemblances entre les deux couples
Destinateur/Destinataire :
« Si le sujet et
l’objet sont apparents dans une relation de présupposition réciproque, le
destinateur occupe une position de commandement face au destinataire »[32]
Un seul acteur peut cumuler plusieurs
fonctions actantielles, le sujet de l’action peut en être le destinataire ;
de même, le destinataire peut être son propre destinateur : communication
réflexive.
L’adjuvant est celui qui
apporte de l’aide en agissant dans le sens du désir.
L’opposant est celui qui
crée des obstacles en s’opposant à la réalisation du désir.
« Tout récit à la
première personne implique que l’acteur, même si on raconte de lui des aventures
lointaines, est en même temps la personne actuelle qui produit de la narration.
Inséparable du sujet de l’énonciation, le sujet de l’énoncé est double »[33]
Le schéma actantiel peut
être représenté ainsi :

Destinateur
Destinataire.
Adjuvant
Opposant.
Nous avons deux schémas
actantiels, celui du «je », et du «il ». La Promenade confronte deux
pôles qui interagissent sur les
transformations mélioratives et péjoratives. Ceci crée deux positions
morphologiques opposées susceptibles d’opérer des transformations narratives.
Les deux pôles fonctionnent suivant une modalisation virtualisante spécifique.
Pour le premier pôle la représentation sera comme suit :
 Destinateur
Objet
Destinataire.
Destinateur
Objet
Destinataire.
J.J.Rousseau
Promenade.
L’humanité.
Adjuvant
Sujet
Opposant
nature
J.J.Rousseau
les humains
(scripteur)
Le J-J.Rousseau dont il
s’agit ici, n’est pas l’être biographique. Il est un être de papier engagé dans
un univers fictionnel car :
«En amont de
l'énonciation, nul embrayage ne peut atteindre l'instance problématique
[l'auteur] et, en aval au-delà de la représentation de l'objet, nul débrayage ne
saurait atteindre le réel »[34]
Cette schématisation
concerne l’acte d’écriture et le pacte qui en résulte. Ce sont les marques
paratextuelles qui manifestent la référence métatextuelle. On peut donc
identifier le narrateur à l'auteur quand il y a référence aux données
biographiques ou autobiographiques comme c’est le cas pour les Promenades qui
évoquent les Confessions et les
Dialogues :
« C'est cet espoir qui m'a fait écrire mes
Dialogues, et qui m'a suggéré mille folles tentatives pour les faire passer à la
postérité » [35]
Si nous passons de
l’énonciation à l’énoncé, nous pouvons déceler les positions actantielles qui
organise la visée pragmatique du « il ».
Une deuxième
représentation actantielle s’impose. Elle a le rôle d’expliciter la
communication d’un objet abstrait
dont la source est le « il ». Le destinataire est dans ce cas un
« je » solitaire :
 Destinateur
Objet
Destinataire
Destinateur
Objet
Destinataire
La haine.
La persécution.
je
Adjuvant
Sujet
Opposant
L’animosité
Les persécuteurs.
Société.
L’articulation semble être ambiguë,
car l’actant est malaisé à traiter ou à déterminer. En raison de sa
diversité, le destinateur est en même
temps le sujet du modèle. La relation est ainsi constitue par l’attitude
même du destinateur.
Le narrateur est un
anti-destinateur puisqu’il s’oppose à la transformation narrative opérée par le
destinateur, qui se subdivise en un destinateur et un sujet
manipulateur.
 Destinateur
objet
destinataire
Destinateur
objet
destinataire
Il
solitude
je
sujet
animosité
Les deux schémas
précédents nous amènent à poser une question d’ordre philosophique, car elle
concerne la dimension ontologique du faire. Le sujet se limite-il à un agent
actif (selon le modèle anthropomorphique) ou y-a-t-il possibilité de considérer
cet agent comme un sujet manipulé ?
Ces deux questions nous
poussent à problématiser les postions du destinateur .
Etant un destinateur, le
narrateur prend la position du sujet manipulateur qui va faire faire un PN
(programme narratif). Mais cette manipulation est réflexive car le sujet
manipulateur qui se charge
d’accomplir le faire narratif (conjonction avec l’Autre).
La narration des
transformations narratives, des états cognitifs et passionnels et la prise en
charge de l’armature du récit pas le discours ( c’est-à-dire la centration du je
dans le texte), placent le narrateur dans le rôle du judicateur qui catégorise
le sujet et l’objet.
Ce rôle place le
destinateur «judicateur » dans un univers pathémique, en plus de son
univers pragmatique et cognitif :
« Outre les dimensions
pragmatique et cognitive, le niveau pathémique dans le quel le destinateur sujet
«passionné » éprouve au terme de son parcours, un état d’âme
euphorique ou dysphorique. »[36]
Nous remarquons que le
passionnel est lié au pragmatique
même s’il n’y a pas d’indices qui manifestent les
transformations :
« La passion, de
fait, ne peut plus être dissociée analytiquement de la double action qui
l’encadre et qui lui confère son statut existant (action, passion,
action)»[37]
2.3. La thématisation
de la position :
La thématisation de la
reconnaissance de la localisation passe par un positionnement dans l’espace
topologique ou topographique, articulant
un univers sémantique et individuel et renvoyant à des catégories
opposées dans des axes sémantiques
hiérarchiques, par l’espace d’apparition et de fonctionnement comme il
est schématisé ici :
s1
vs
s2

S
s3
vs
s4
S¢
Nous pouvons exploiter
cette schématisation pour montrer l’articulation de deux thématiques qui
s’arrangent autour du paraître. Il suffit d’examiner le segment suivant :
«Oui, sans doute, il faut que j’aie fait sans que je
m‘en aperçusse un saut de la veille au sommeil ou plutôt de la vie à la
mort ». [38]
En analysant cette
séquence textuelle, nous pouvons déceler deux axes sémantiques : le premier
concerne l’existence : vie/mort.
vie
vs
mort
existence
Le deuxième concerne la
conscience : veille/sommeil.
S
veille
vs
sommeil
conscience
L ‘évocation des passages de la vie
et de la mort renvoie à un devenir combinant le /terminatif/ et le
/duratif/.
On peut graduer la relation entre les
deux axes sémantiques, en spécifiant les catégories et leurs espaces
d’apparition, car la relation d’enchâssement n’est pas donnée d’emblée par une
encyclopédie sémantique préalable et parce que le texte ne définit aucune
stratification quant aux plans de chaque axe. Cette affirmation ne contredit pas
l’affirmation selon laquelle la langue est une institution , seulement, il faut
rappeler que l’homme est ancré dans le monde : «parce que nous sommes au monde, nous sommes condamnés au sens, et nous ne pouvons
rien faire ni dire qui ne prenne un nom dans l’histoire »[39]
Ainsi, nous avons besoin
d’un niveau élémentaire pour chaque axe
sémantique pour montrer les
traits minimaux et leur articulation dans une structure
logique : «C’est le carré sémiotique qui représente les relations
principales auxquelles sont nécessairement soumises les unités de signification
pour pouvoir engendrer un univers sémiotique susceptible d’être
manifesté ».[40]
Dans le carré
sémiotique, un actant peut assumer quatre positions actantielles à partir
desquelles il remplit des rôles dans la progression du discours
narratif.
Le carré sémiotique est le modèle
constitutionnel de la théorie greimassienne, les contenus dont les sommets du
carré sont investis peuvent alors s’obtenir par des relations syntaxiques
réelles : négation puis assertion des contenus opposés, comme l’écrivait
Greimas :
« C’est la
sommation du terme S1 qui fait apparaître le terme contradictoire. La structure
de la contradiction n’est donc pas une structure de type présence/absence, c’est
au contraire l’absence faisant surgir la présence : non S1 est déjà le
premier terme positif »[41]
.
Avec le carré
sémiotique, on situe la valeur que l’Objet représente pour un Sujet, dans un système de valeurs pour
soutenir l’organisation narrative du texte :
 Valeur A
Valeur B
Valeur A
Valeur B
Non Valeur B
Non valeur A
Appliqué à la position de S1 le classement des
figures de la conscience donnera ceci :
veille
sommeil
 sans doute
sans doute
voulue
saisie
non sommeil
non veille
A ces figures de la conscience s’ajoutent
celles de l’existence que l’on peut représenter comme ceci.
S
s 3
s4
/ vie /
/ mort /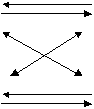
non s4
non s3
/non mort
/
nonS
/
non vie /
Notons d’abord que
l’absence d’une hiérarchie apparente entre les deux axes : le couple
veille/sommeil constitue une thématisation englobée et spécifique par opposition
à celle de vie/mort : thème englobant et plus générique, si l’on tient
compte de l’articulation des catégories des deux couples représentants la saisie
de S1. On peut dés lors mettre le doigt sur la dynamique passionnelle et
cognitive des sujets observateurs.
Nous pouvons aussi projeter les deux positions sémiotiques
pour montrer l’aspect véridictionnel :
«…je suis dans cette
étrange position, elle me paraît encore un rêve ….et que je vais me
réveiller…»[42]
vérité
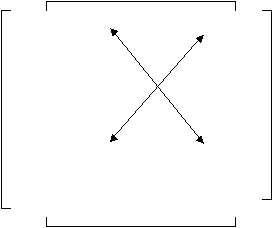
/être/
/paraître/
étrange position
rêve
secret
mensonge
/non paraître/
/non être/
non rêve
réveil
fausseté.
Nous pouvons prévoir une lecture syntagmatique de la tentative de
reconnaissance de la position (objet, valeur de la quête) articulée d’un
paraître vers un être :
 Etre
paraître
Etre
paraître
(réveil)
(rêve)
non
paraître
non rêve
2.4.
De l’aspectualisation à la temporalisation :
Remarquons que le faire est inscrit dans la temporalité
est cadré par le préjugé. Remarquons également que l’aspectualisation est une
dimension hiérarchiquement supérieure à la temporalisation mais aussi à la l’actorialisation, la
domination de l’aspect inchoactif
dans la valorisation de la dimension ontologique de l’identité et de l’altérité.
En parallèle, cet aspect inchoactif se combine avec l’aspect terminatif justifié par la visée stratégique de la quête car la
protensivité du «je » est une interprétation apriorique et une valorisation
anticipatrice. De ce fait, le faire narratif dissimule un «métasavoir »,
concernant l’ontologie de l’être et la dialectique de l’identité et de
l’altérité. Ce métasavoir crée un métavouloir renvoyant à un positionnement
phorique.
Il convient donc d’insister sur la complexité de la
modalisation volitive ; en
effet, deux vouloirs contraires coïncident dans l’attitude de
S1.
|
Attitude pragmatique. |
Attitude épistémique et
passionnelle. |
|
S1 ∩ S2 |
S1 U
S2 |
La première attitude manifeste le
parcours narratif et la valeur investie selon la performance, la deuxième
manifeste un jugement de valeur qui se fonde sur le caractère inchoactif
et terminatif en même temps.
2.5. la
complexité de l’aspect axiologique de la Compétence/ Performance :
En faisant une lecture syntagmatique, on peut donner un autre aspect à la
valeur sémantique de la performance. Il y a en effet deux
lexèmes prédominants sémantiquement: franc, ouvert dans la séquence suivante
:
«Sans adresse, sans art, sans dissimulation, sans
prudence, franc, ouvert… » [43]
Ces deux
lexèmes sont susceptibles d’axiologiser l’état et le faire de S1.
Il est à signaler qu’une lecture de la thématisation de la performance
expliquant l’axe sémantique du faire explicite deux axes dominants : le premier
est «éthique », le deuxième spatialise l’aspect de ce même
faire.
S1
S2
 (franchise)
(hypocrisie)
(franchise)
(hypocrisie)
non S2
non S1.
(non hypocrisie)
(non franchise)
Le deuxième
est comme suit :
 S3
S4
S3
S4
(ouverture)
(fermeture)
Non
S4
non S3
(non
fermeture)
(non ouverture)
S’il est admis que l’ouverture est un indice abstrait (dont l’iconicité
peut se manifester par différents moyens) de la socialité voire la sociabilité.
Le texte de Rousseau dévoile l’impertinence de ce jugement préalable et
préconçu.
On peut
représenter cette divergence entre la spatialité inhérente au texte comme
ceci :
S1
S2
(ouverture)
(fermeture)
 socialité*
asocialité
socialité*
asocialité
sociabilité
asociabilité
non S2
non S1
(non fermeture)
(non ouverture)
non asocialité
non socialité
non asociabilité
non sociabilité
Cette spatialisation des relations est
communément employée pour montrer l’accès de l’identité à/chez l’altérité et
vice versa, c’est-à-dire segmentation qui différencie l’espace publique de
l’espace privé et de l’espace même de l’Autre.
La Promenade fonctionne selon les points de la focalisation et par
rapport à un système d’opposition préétablie. La disjonction avec
l’autre « fermeture par rapport l’autre » accentue la
conjonction avec soi.
La
spatialisation inhérente au texte peut dés lors être représenté comme
ceci :
S3
S4
 (ouverture)
(fermeture)
(ouverture)
(fermeture)
Non S4
non S3
(Non fermeture)
(non ouverture)
2.6. La
complexité de l’aspect axiologique de la sanction :
On est amené à reconnaître que la complexité de l’aspect axiologique de
la compétence/performance est amplifiée par la complexité de la sanction, qui
est réflexive et transitive en même temps : elle est réflexive parce que S1
s’érige en judicateur qui évalue son propre état passionnel et sa propre
performance ; elle est transitive parce que S2 est amené à donner concernant la performance de
S1.
Il est établi
que le texte est un artifice syntaxico-sémantico-pragmatique. Ainsi, tout
lecteur se doit de résister à ce qui offert par la dimension
dictionnairique à première vue,
mais il est axiomatique d’affirmer que la signifiance d’un texte dépend d’une
sémantique du mot et d’une encyclopédie qui arrange l’univers du texte. C’est un
aspect paradoxal qui donne un statut au
texte. Convenant donc de vérifier la composition de l’univers sémantique,
sémémique et métasémémique des constituants leximatique.
Pour rendre
compte de la performance de S1 et de sa modalisation et de son axiologisation,
il est indispensable d’inscrire la sanction dans un système de valeurs qui
débordent une encyclopédie sémantique, voire idéologique ou anthropologique tout
en s’appuyant sur elle.
On est de ce
fait confronté à ce que le texte édifie comme catégorie.
«Sentant enfin tous mes efforts inutiles et me
tourmentant à pure perte j’ai pris le seul parti qui me restait à prendre, celui
de me soumettre à ma destinée sans plus regimber contre la nécessité » [44].
Dans ce segment, nous pouvons formuler la modalisation
du faire comme une alternance entre un échec au niveau actualisant et la
catégorisation affective.
![]() Non
pouvoir faire
non faire
Non
pouvoir faire
non faire
Non pouvoir
être
être
Non savoir
faire
non faire
Ces faire
modalisateurs sont dominés par le volitif dans la mesure ou’ il intervient après
la réitération de la performance : «je me suis débattu longtemps »,
et sa qualité /agressivité/ : «aussi
violemment » [45].
Constatant que
les valeurs obéissent à une dynamique et qu’il y a un changement de statuts si
on compare l’avant et l’après performance.
La dynamique
des valeurs n’est pas sans incidence par rapport au faire et à l’être,
et si nous approchons des lexèmes qui
qualifient la performance de S1 isolément nous pouvons confronter l’aspect
péjoratif au mélioratif.
faire
l’être
 |
aspect
mélioratif
aspect péjoratif
se
débattre(faire) :
se soumettre(non faire) :
transformations «longtemps »
«mes efforts inutiles »
« violemment »
résultats
« vainement »
«destinée »
« néécessité »
valeur
valeur
individuelle.
universelle
« ma »
« la »
enlacement «sans
art »
Faire
contraire de l’anti-sujet : complicité « leur donner de
nouvelles prises qu’ils n’ont eu garde de négliger ».
A l’issue de
ce travail nous avons pu constater que la première Promenade de J.J.Rousseau est structurée selon une stratégie
textuelle et discursive visant la narration d’un «état d’âme » mais aussi
l’argumentation justifiant du coup l’acte de l’écriture et rationalisant une
représentation dépréciative concernant la relation du Même avec
l’Autre.
Ajoutons que
le narratif ne peut être mis en évidence que si l’on postule que la narrativité
comme phénomène ou aspect discursif coexiste avec les autres aspects génériques
du discours même pour ceux qui peuvent apparaître divergents à première vue.
Notre corpus manifeste très bien cela, car il est un texte hétérogène du point
de vue générique. Et bien que relevant d’un genre inédit, la
Promenade n’a pas pu échappé aux aspects
généraux des textes dont l’hétérogénéité générique.
Ceci étant,
la Promenade semble s’engager dans le
narratif à deux niveaux :
- Le premier
est général car toute performance langagière est une énonciation.
- Le
deuxième est spécifique et reconnaissable grâce aux marques de
l’énonciation.
Notre
travail qui se voulait systémique a essayé de ce fait de montrer le statut
énonciatif et énoncif de
l’incipit, tout en insérant la phrase
introductive dans la globalité du texte. Cet objectif nous a conduit à concevoir
la phrase introductive comme un élément relevant de la textualité du
paratextuel en même temps. Il est ainsi permis de le concevoir comme un artifice
métatextuel de par sa dimension fonctionnelle.
Remarquons
aussi que l’incipit coïncide
thématiquement avec la séquence résultative de la narrativité. Le «donc » marque alors le
point d’arrivé dans le parcours thématique de l’acteur de la
narration.
Bien que le modèle actantiel soit un outil
simplificateur des positions narratives, il n’exclut pas la complexité des
schémas qu’institue le texte. Dans la première Promenade ceci est avéré par les positions des
acteurs.
La
Promenade dévoile par ailleurs un
paradoxe confrontant l’état voulu et la transformation acceptée (solitude) à
l’acte d’écriture qui est l’élimination de celle-ci. Car il est une
conjonction actorielle qui lie un
auteur/énonciateur et un lecteur/ énonciataire.
De ce point
de vue, la justification de l’écriture est un élément métatextuel qui rationalise l’acte d’écriture mais qui
n’exclut pas la fonction séductive et
justificatrice.
Quant à l’énonciation, il nous est à présent possible de
dire qu’elle englobe des instances qui instituent un contrat spécifique selon la
représentation de l’énonciateur et de l’énonciataire.
Cette approche nous a permis entre autre de constater que la
Promenade retrace toute la chaîne de la
narrativité selon deux points de focalisation différents, celui engagé par
la modalisation virtualisante du « je », et celui mis en œuvre par le
« il ». Nous retrouvons donc deux parcours opposés, l’un vise la
péjoration et l’autre l’amélioration.
La première des phases de la narrativité est la manipulation. Celle-ci
est réflexive dirigée de l’acteur vers lui-même. A cette communication d’un
objet cognitif et épistémique s’additionne
la communication transitive. Elle apparaît dans le vouloir être souhaité
à l’être biographique (Jean-Jacques Rousseau) dans la réception de l’œuvre (les
Promenades) et de son
auteur.
Il est à remarquer que la première Promenade fonctionne selon une complexité de l’aspect
axiologique de la compétence et de la performance. Cette complexité est amplifiée par la composition de la
sanction, vu que cette dernière est réflexive et transitive en même temps. La
réflexivité de la sanction érige le «je » en judicateur, dont la
performance est l’évaluation de son propre état passionnel et la localisation
par rapport à l’altérité. En revanche, la transitivité est motivée par un
jugement épistémique qui classe l’altérité et l’identité selon une dialectique
marquée par l’aspect polémique.
Disons enfin que le récit déployé par la Promenade cadre l’action par l’être du faire et le faire être.
Ce qui donne un enjeu quant aux faires et une modalisation des états et des
transformations opérées par les acteurs de la Promenade.
MEDJDOUB
Zahra.
Université
de Tlemcem
(Algérie)
**Cette étude paraîtra prochainement dans le Numéro 16 de la
revue Etudes J.-J. Rousseau
.© Medjdoub
Zahra.